|
Ma démarche
Comment puis-je affirmer
raconter ici l’histoire de l’exploration spatiale comme on ne l'a jamais
fait?
C’est par inadvertance
que j’en suis venu à ce constat.
Me passionnant pour
l’exploration spatiale depuis plus de quarante ans (voir ci-contre), j’ai
récemment entrepris de relire le New York Times des années
1950 pour voir comment on y décrivait les événements.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ceux-ci ne sont pas
relatés tels que je les ai si souvent lus ailleurs. Plusieurs articles
vont même à l’encontre de ce que «tout le monde sait».
J’ai aussi découvert quantité de faits significatifs que
l’Histoire néglige depuis.
Évidemment,
nous savons beaucoup plus de choses aujourd’hui qu’à l’époque,
notamment grâce aux recherches historiques qui ont été
réalisées ainsi que par le biais des biographies et mémoires
rédigés par ceux qui ont participé à l’aventure.
C’est particulièrement le cas avec l’ouverture des archives soviétiques
et du fait que les pionniers russes peuvent enfin parler.
Il ressort de tout
ceci une «triple» histoire. Il y a d’abord celle connue
du grand public et qu’on retrouve dans bon nombre d’ouvrages. Il y a ensuite
l’histoire pour les spécialistes, les ouvrages savants qui fouillent
à fond divers aspects de l’exploration spatiale. Il y a enfin l’histoire
telle que relatée au quotidien par un journal aussi crédible
que le New York Times. Or, si chacune raconte la même
trame de fond, chacune rapporte pourtant un récit assez différent.
Les Spoutnik et Laïka
Pour vous donner
une idée, je citerai les faits suivants qui, bien qu’il s’agisse
de détails, colorent néanmoins différemment l’histoire
généralement acceptée.
La grande majorité
des livres relatent que le 4 octobre 1957, les Soviétiques ont surpris
le monde en lançant Spoutnik 1 puis, un mois plus tard, Spoutnik
2 avec à bord le chien Laïka. Or, lorsqu’on lit les journaux
de l’époque, on découvre non seulement qu'on avait été
prévenu mais, surtout, que les deux satellites ne s’appellent pas
Spoutnik. Ils n’ont pas de noms. Pour les Soviétiques, il
s’agissait simplement du «premier satellite artificiel de la Terre»
et du «deuxième satellite artificiel de la Terre».
De même pour Laïka: ce n’était pour eux qu’un animal
de laboratoire, sans nom, de race laïka (une lignée de chiens
eskimo).
C’est plutôt
nous en Occident qui avons plus tard nommé ces satellites Spoutnik
1 et Spoutnik 2. De même, nous avons baptisé le chien
Laïka, celui-ci représentant à nos yeux bien plus qu’un
spécimen de labo. (Les Russes ont fini par adopter nos appellations.)
Deux poids, deux mesures
Mais il y a plus
encore. En lisant les journaux de l’époque, on découvre une
foule de faits qui laissent songeurs.
Par exemple, au
lendemain du lancement de Laïka, nos sociétés de protection
des animaux ont protesté contre le fait que le «pauvre petit
chien» allait mourir dans l'espace après quelques jours de
vol. Par contre, au même moment, la rumeur a couru à
l’effet que les Soviétiques auraient lancé une bombe atomique
en direction de la Lune. Apparemment, cette bombe allait exploser
au moment de l’impact afin de prouver au monde entier que les Soviétiques
auraient bien atteint la surface lunaire! Or, curieusement, personne
n’a protesté contre un projet aussi grotesque. C’est dire qu’à
l’époque, on acceptait l’idée de faire sauter des bombes
atomiques dans l‘espace, tout en déplorant le sort réservé
à un pauvre animal «sacrifié au nom de la science».
De même, on
découvre que, pendant que le président des États-Unis
préconisait l’exploration exclusivement pacifique de l’espace, ses
généraux préparaient nombre de projets spatiaux militaires.
Quantité
de faits du genre et à présent oubliés donnent une
autre vision de ce qu’ont été les années passées.
Vous constaterez d'ailleurs que bon nombre des chroniques mensuelles recèlent
ce genre de «perles».
La Grande aventure / The Great Adventure
À présent,
non seulement avons-nous l’avantage de bénéficier du recul
du temps mais les connaissances historiques acquises nous permettent de
voir ce qui se passait en coulisse.
C’est ainsi qu’en
dressant le parallèle entre les informations d‘époque et
ce qu’on sait à présent, on obtient un récit historique
différent de ce qu’on raconte habituellement.
Pour parvenir à
ce résultat, j’ai d’abord construit un site Internet qui met en
parallèle (sur deux colonnes) l’information connue au moment des
événements et ce que nous savons à présent.
Cette recherche fait l’objet d’un site anglais intitulé The
Great Adventure Project.
Ce site rassemble
une collection de courts articles (le résumé des textes d’origine)
placés par ordre chronologique. Dans tous les cas, j’indique la
source (avec hyperlien) à l’intention des lecteurs avides d’en savoir
plus.
À partir
de ce site, je rédige ensuite les chroniques meusuelles qui composent
le récit de La Grande aventure spatiale. Résultat:
un lecteur bilingue a la chance de lire une bonne synthèse de l’exploration
spatiale d’un mois puis de consulter la chronologie correspondante pour
approfondir ses connaissances.
Voilà pourquoi,
à la fin de chaque chronique, j’indique deux hyperliens. Le premier
vous convie à lire la suite du récit et le second la chronologie
détaillée des événements qu’on vient de couvrir.
À vous de choisir la voie qui vous conviendra le mieux.
Évidemment,
rédiger le récit de l’exploration spatiale de mois en mois
représente une tâche colossale qui nécessitera des
années de labeur. (Je prévois y consacrer le reste de mes
jours.) J’espère pouvoir ajouter régulièrement des
épisodes. De la sorte, vous vivrez avec moi une aventure de découvertes
qui s’annonce longue et palpitante!
De retour à la page d'Accueil. |
|
Enfant de l’espace
Je suis ce qu’on
pourrait appeler un «enfant de l’espace», même si, bien
entendu, je ne suis pas né dans l’espace.
Je me considère
comme tel parce qu'entre autres, je suis né au début de l’ère
spatiale et parce que celle-ci jalonne mon existence.
En effet, lorsque
les Soviétiques ont lancé le premier satellite, Spoutnik,
j’étais à sept mois de naître. Je me plaît
à penser que c’est probablement vers ce 4 octobre 1957 que ma mère
a pris conscience qu’elle me portait. L’idée de mon existence coïncide
peut-être avec celle du premier satellite!
Je suis né
un mardi soir, le 6 mai 1958, à Montréal.
Les graines de la passion
Le premier souvenir
que je conserve de ma petite enfance remonte à l’après-midi
du 20 février 1962. J’ai 3 ans et 9 mois. Je me revois encore
jouant dans la cuisine auprès de ma mère qui fait son repassage.
Son programme-radio est constamment interrompu par des bulletins spéciaux.
Je comprends qu’il se passe quelque chose, sans bien entendu réaliser
de quoi il s’agit. Il y a, dit-on, un homme dans l’espace.
 La radio couvre en fait l’envolée de John
Glenn, le premier Américain en orbite. Évidemment,
à l’âge que j’ai, je ne puis comprendre ce dont on parle mais
cela pique ma curiosité. C’est probablement la première fois
que je prends conscience d’une réalité hors de mon petit
monde d’enfant.
La radio couvre en fait l’envolée de John
Glenn, le premier Américain en orbite. Évidemment,
à l’âge que j’ai, je ne puis comprendre ce dont on parle mais
cela pique ma curiosité. C’est probablement la première fois
que je prends conscience d’une réalité hors de mon petit
monde d’enfant.
Avant son mariage,
ma mère a été institutrice dans une petite école
de campagne. Étant naturellement pédagogue, elle m’enseigne
à lire, à écrire et à compter. Sa méthode
repose sur le jeu. Par exemple, elle dessine une échelle où,
entre chaque barreau, elle place des syllabes, des mots ou des nombres.
À moi de les déchiffrer pour grimper l’échelle!
Ce faisant, maman m’enseigne qu’apprendre est une activité amusante.
Voilà l’une des plus précieuses notions que Gabrielle me
lègue et qui guide mon quotidien aujourd’hui encore.
 En mai 1963, alors que je viens d’avoir 5 ans, j’entreprends de lire les
gros titres du journal
La Presse qui traîne sur la table de
la cuisine. Coïncidence, le quotidien titre «Cooper est
en orbite». L’article relate le vol de l’astronaute américain
Gordon
Cooper.
En mai 1963, alors que je viens d’avoir 5 ans, j’entreprends de lire les
gros titres du journal
La Presse qui traîne sur la table de
la cuisine. Coïncidence, le quotidien titre «Cooper est
en orbite». L’article relate le vol de l’astronaute américain
Gordon
Cooper.
 Six mois plus tard, ma curiosité d’enfant est piquée au vif
par l’assassinat du président Kennedy.
Bien que j’aie peu de souvenirs de ce drame, ma mère raconte qu’à
l’époque, je suis demeuré rivé au petit écran.
(Treize ans plus tard, je serai extrêmement ému de me retrouver
au cimetière d’Arlington, sur la tombe du président Kennedy,
comme si je reconnaissais les lieux.)
Six mois plus tard, ma curiosité d’enfant est piquée au vif
par l’assassinat du président Kennedy.
Bien que j’aie peu de souvenirs de ce drame, ma mère raconte qu’à
l’époque, je suis demeuré rivé au petit écran.
(Treize ans plus tard, je serai extrêmement ému de me retrouver
au cimetière d’Arlington, sur la tombe du président Kennedy,
comme si je reconnaissais les lieux.)
 Il ne fait aucun doute que ces événements ont semé
les germes qui ont fait naître en moi la passion des sciences et
de l’actualité. C’est ainsi qu’à 8 ans, j'arrête
de jouer lorsque la radio annonce que trois astronautes viennent de brûler
vifs à bord de la cabine d’Apollo
1 (ci-contre). J’ai aussi conscience des assassinats de Martin
Luther King et de Bobby
Kennedy. Dans ce dernier cas, je passe les jours suivants rivé
à la télé à suivre les événements
entourant ses funérailles. Évidemment, dans les trois cas,
je suis encore trop jeune pour réaliser la portée de ces
événements. Je commence néanmoins à lire
les journaux, cherchant à comprendre…
Il ne fait aucun doute que ces événements ont semé
les germes qui ont fait naître en moi la passion des sciences et
de l’actualité. C’est ainsi qu’à 8 ans, j'arrête
de jouer lorsque la radio annonce que trois astronautes viennent de brûler
vifs à bord de la cabine d’Apollo
1 (ci-contre). J’ai aussi conscience des assassinats de Martin
Luther King et de Bobby
Kennedy. Dans ce dernier cas, je passe les jours suivants rivé
à la télé à suivre les événements
entourant ses funérailles. Évidemment, dans les trois cas,
je suis encore trop jeune pour réaliser la portée de ces
événements. Je commence néanmoins à lire
les journaux, cherchant à comprendre…
 Heureusement, mon enfance n’est pas jalonnée que par des tragédies,
puisque j’ai aussi le privilège de connaître le fabuleux été
de l’Expo 67 – l’exposition
universelle de Montréal. Hélas, à 9 ans, je
suis encore trop jeune pour vraiment profiter de cette ouverture exceptionnelle
sur le monde. Je conserve en fait peu de souvenirs de l’Expo, si ce n’est
d’y être allé deux ou trois fois et, surtout, qu’il y avait
énormément de monde! Le souvenir que j’en garde plutôt,
c’est de m’être mis à collectionner les articles de journaux
qui en parlaient - découpures que je colle dans des «scrap
books» que je possède encore.
Heureusement, mon enfance n’est pas jalonnée que par des tragédies,
puisque j’ai aussi le privilège de connaître le fabuleux été
de l’Expo 67 – l’exposition
universelle de Montréal. Hélas, à 9 ans, je
suis encore trop jeune pour vraiment profiter de cette ouverture exceptionnelle
sur le monde. Je conserve en fait peu de souvenirs de l’Expo, si ce n’est
d’y être allé deux ou trois fois et, surtout, qu’il y avait
énormément de monde! Le souvenir que j’en garde plutôt,
c’est de m’être mis à collectionner les articles de journaux
qui en parlaient - découpures que je colle dans des «scrap
books» que je possède encore.
C’est dans ce contexte
que je me mets à feuilleter les magazines laissés derrière
par les adultes, à la recherche de reportages sur les technologies
modernes. Je me rappelle encore de certains qui m’ont émerveillé,
dont un reportage magnifiquement illustré sur un porte-avion nucléaire
et un autre sur le paquebot France publiés dans Paris-Match.
Il y a en outre celui du Science & Vie qui présente l’exploration
spatiale des années 2000.
.
.
Comment on voyait l'an 2000 en 1965
.
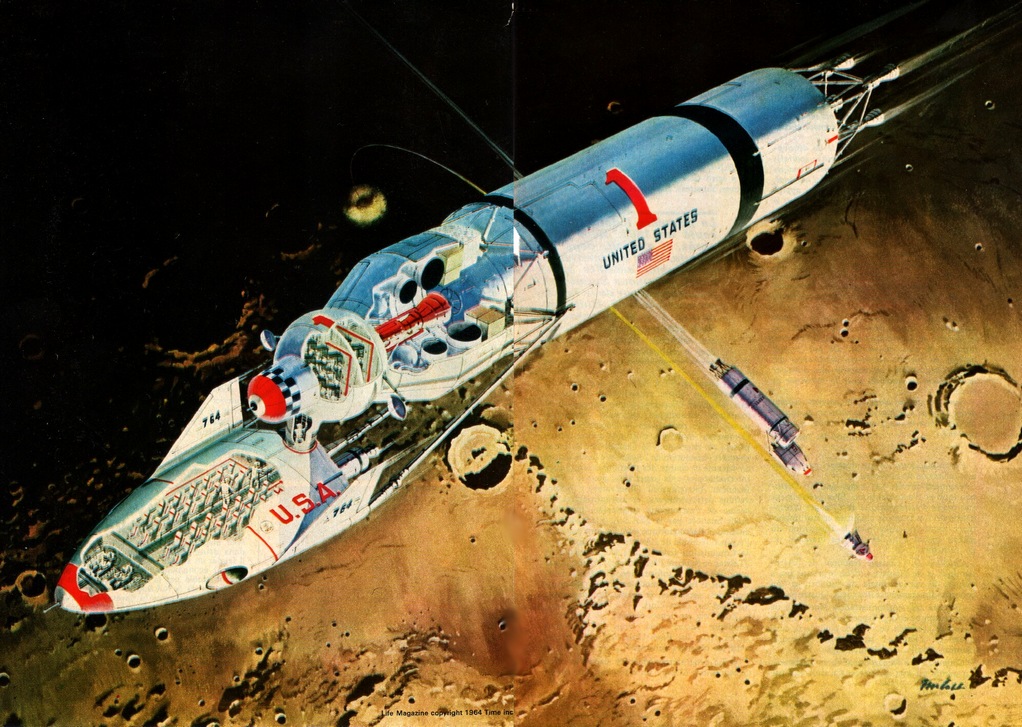
«Pour desservir les bases
humaines qui seront sans doute installées avant la fin du siècle,
il faudra un service de transporteur régulier. Le véhicule
passager (à l’avant) vient s’accrocher à une navette nucléaire
qui le transporte au voisinage de la Lune.»
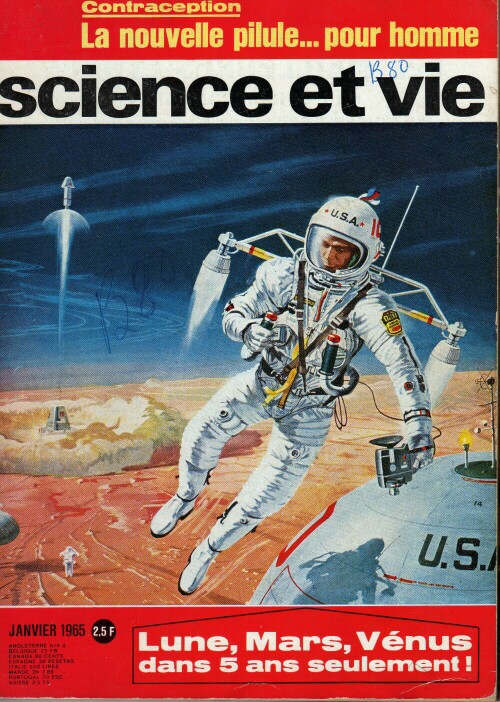 Deux tableaux de Robert McCall (ci-haut et ci-dessous) publiés par
Science
& Vie en janvier 1965 et qui ont fait rêver l’enfant que
j’étais. J’ai passé des heures à contempler ces images
en me disant que voilà ce que serait un jour ma réalité:
un monde où on vivrait et travaillerait dans l’espace.
Deux tableaux de Robert McCall (ci-haut et ci-dessous) publiés par
Science
& Vie en janvier 1965 et qui ont fait rêver l’enfant que
j’étais. J’ai passé des heures à contempler ces images
en me disant que voilà ce que serait un jour ma réalité:
un monde où on vivrait et travaillerait dans l’espace.
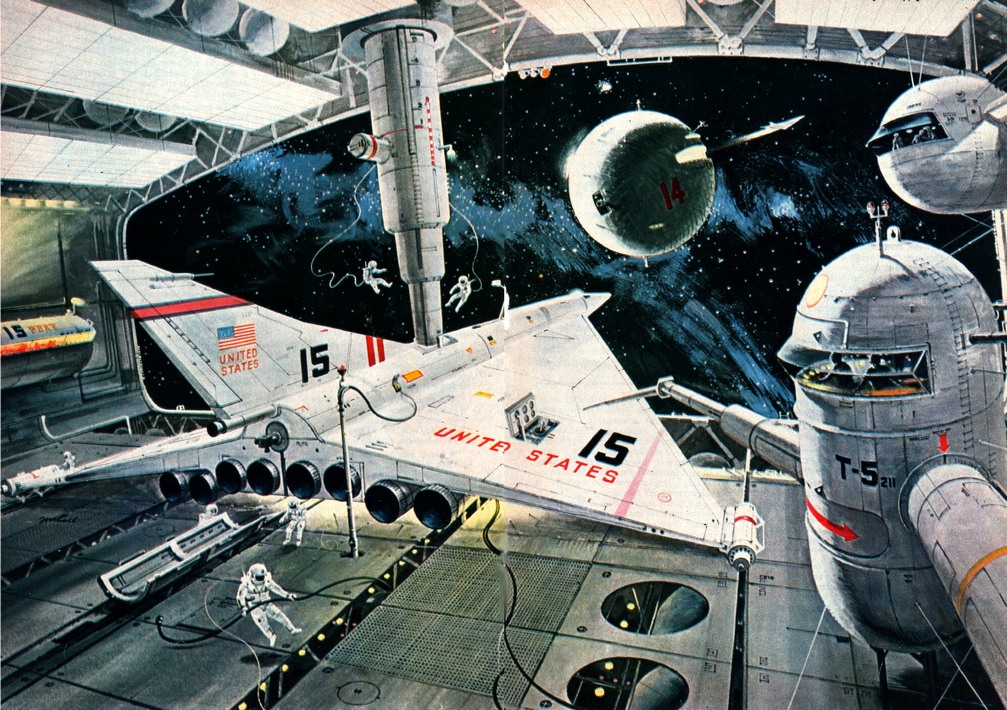
«Avant la fin du millénaire,
des stations orbitales ceintureront la Terre. Elles pourront être
du type illustré ici… Une de leurs fonctions principales sera de
servir de bases de départ et d’arrivée pour les fusées
interplanétaires. Une navette comme celle représentée
dans notre dessin quitterait la Terre et rejoindrait la station orbitale
où elle “viendrait à quai”…» |
Coup de foudre
Au soir du 24 décembre
1968, ma famille et moi sommes réunis en cette veille de Noël
dans notre petit chalet de Clarence Creek, en banlieue d'Ottawa. J'ai dix
ans. Pendant que maman nous prépare, mes trois frères et
moi, pour la messe de minuit, papa regarde la télé. L'image
est de si 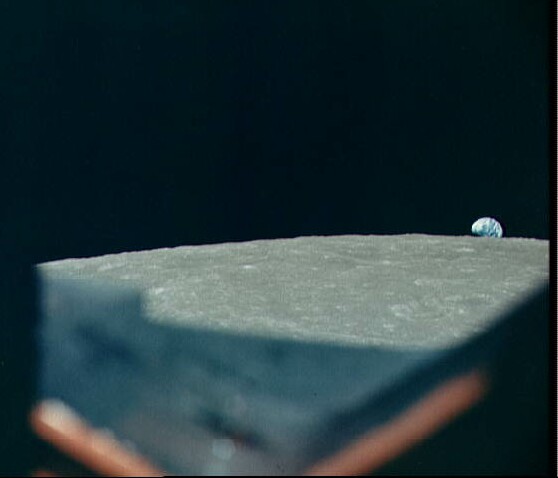 piètre
qualité que je n'arrive pas à distinguer grand-chose. P'pa
m'explique qu'il s'agit d'une diffusion télé en direct de
la Lune; pour la première fois des hommes gravitent autour de notre
satellite naturel. piètre
qualité que je n'arrive pas à distinguer grand-chose. P'pa
m'explique qu'il s'agit d'une diffusion télé en direct de
la Lune; pour la première fois des hommes gravitent autour de notre
satellite naturel.
L'idée me
traverse l'esprit: quelle aventure fantastique!
En marchant vers
l'église, par cette belle et froide nuit d'hiver, j'admire la Lune
en songeant que trois hommes se trouvent non loin d'elle. Dès le
lendemain, je me plonge dans la lecture des journaux des derniers jours
(Le Droit d’Ottawa) pour y découvrir l'étonnante odyssée
des astronautes d’Apollo
8. Je passe donc ce 25 décembre la tête dans les
journaux!
Ma vie en est à
jamais changée: je suis frappé d'un coup de foudre! En moi
naît une passion qui ne cessera de croître.
L’été
suivant, je suis rivé à la radio, à la télé
et me gave de journaux pour suivre toutes les péripéties
du premier débarquement sur la Lune: la mission Apollo
11. Aujourd’hui, je conserve en mémoire l’effervescence
qui a marqué le week-end du 19-20 juillet, alors que trois astronautes
réalisent l’un des vieux rêves de l’humanité.
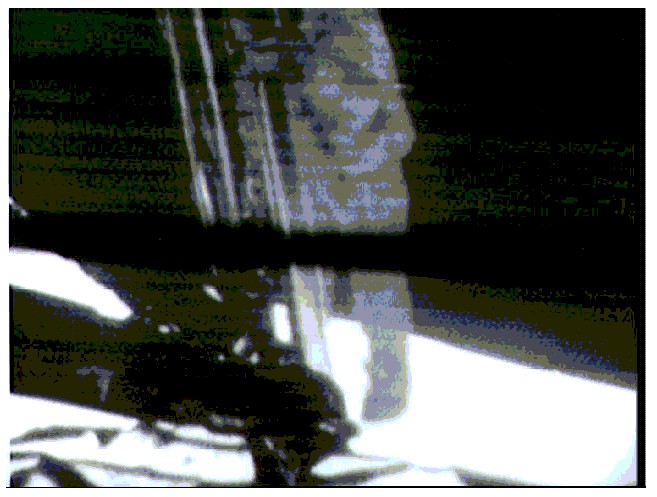 En ce dimanche soir, 20 juillet, j’obtiens même la permission de
me coucher très tard (vers minuit). À 22h55, en famille,
nous regardons Neil Armstrong faire son «petit pas pour un homme,
un bond de géant pour l’humanité». (Trente-cinq ans
plus tard, je relaterai La
Grande aventure d’Apollo 11 en espérant faire revivre ce
qu’a été ce moment époustouflant de notre histoire.)
En ce dimanche soir, 20 juillet, j’obtiens même la permission de
me coucher très tard (vers minuit). À 22h55, en famille,
nous regardons Neil Armstrong faire son «petit pas pour un homme,
un bond de géant pour l’humanité». (Trente-cinq ans
plus tard, je relaterai La
Grande aventure d’Apollo 11 en espérant faire revivre ce
qu’a été ce moment époustouflant de notre histoire.)
Les retombées d’une passion
 À partir de là, l'exploration spatiale devient ma passion.
Toutes les autres activités – y compris mes études et, plus
tard, ma carrière – y sont subordonnées. (Ci-contre,
à 12 ans avec mon petit chien Tamy.)
À partir de là, l'exploration spatiale devient ma passion.
Toutes les autres activités – y compris mes études et, plus
tard, ma carrière – y sont subordonnées. (Ci-contre,
à 12 ans avec mon petit chien Tamy.)
C’est ainsi que
je me mets à écouter au quotidien les bulletins de nouvelles
ainsi qu’à feuilleter les journaux et les magazines à la
recherche d’articles sur l‘espace. Ce faisant, je m’ouvre au monde, découvrant
la réalité de sociétés méconnues comme
l’Union soviétique, ainsi que la politique internationale. Je réalise
que nous sommes en pleine guerre froide, que les États-Unis et l’URSS
se livrent non seulement une course dans l’espace mais une guerre de tous
les instants un peu partout sur la planète (au Vietnam, à
Cuba, au Chili…). Cela m’amène à m’intéresser à
l’histoire et à la géographie, afin de comprendre l’origine
des faits d’actualité.
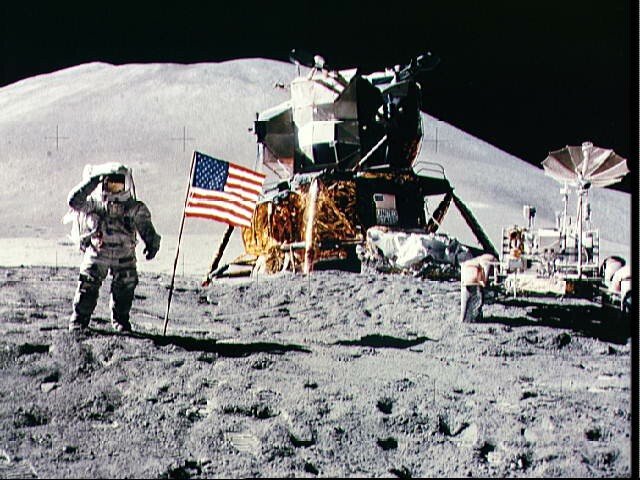 Chaque fois que des astronautes s’envolent pour l'espace ou qu’ils y réalisent
des exploits, je m'absente de l'école ou de mon lieu de travail.
Ô bonheur, les premières années de ma passion sont
jalonnées par les six expéditions lunaires Apollo.
Chaque fois que des astronautes s’envolent pour l'espace ou qu’ils y réalisent
des exploits, je m'absente de l'école ou de mon lieu de travail.
Ô bonheur, les premières années de ma passion sont
jalonnées par les six expéditions lunaires Apollo.
J’ai aussi la chance
de passer mes étés à Terre des hommes, le site d’Expo
67 où, dans les années subséquentes, divers pays y
présentent de belles expositions. Les premières années,
il y a même un pavillon dédié à l’espace où,
je le réalise à présent, on présentait 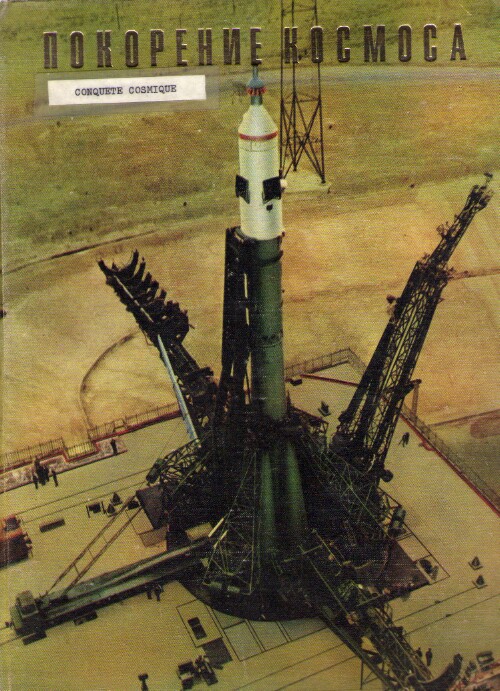 des
pièces remarquables. C’est aussi pour moi l’occasion de découvrir
l’Union soviétique, dont le pavillon regorge année après
année de matériel et de documents spatiaux de grande qualité.
(Je m’y procure des livres russes sur l’espace qui sont rares en Occident
(ci-contre) et qui m’inciteront, des années plus tard, à
apprendre les rudiments de cette langue.) des
pièces remarquables. C’est aussi pour moi l’occasion de découvrir
l’Union soviétique, dont le pavillon regorge année après
année de matériel et de documents spatiaux de grande qualité.
(Je m’y procure des livres russes sur l’espace qui sont rares en Occident
(ci-contre) et qui m’inciteront, des années plus tard, à
apprendre les rudiments de cette langue.)
Mon intérêt
pour l’actualité et les questions internationales a parfois des
«retombées» inattendues. Ainsi, le fait de suivre au
quotidien ce que font les Américains et les Soviétiques dans
l‘espace me permet de voir à l’œuvre les deux idéologies
rivales. Le fait d’observer ainsi comment le communisme et le capitalisme
fonctionnent dans la réalité – la première dans le
plus grand secret et la seconde au vu et au su de tous – m’amène
à me forger une opinion sur leur valeur.
Mon intérêt
pour le spatial a bien entendu d’importantes répercussions sur mes
études. Non seulement me suis-je intéressé aux sciences,
mais je suis avide de lire tout ce qui me tombe sous la main, y compris
de gros bouquins. J’apprends avec hâte l’anglais afin de pouvoir
comprendre les publications de la NASA que j’accumule.
Bien entendu, les
sciences deviennent ma matière favorite et ce penchant me conduira
tout naturellement à entreprendre une carrière de journaliste
scientifique. À partir de 1983, j'allie donc l'utile à la
passion en devenant journaliste spécialisé dans l’exploration
spatiale. Je bénéficie ainsi de l'ultime privilège
de pouvoir gagner ma vie tout en faisant ce que j'aime. Je vis mon rêve
et mon rêve me fait vivre!
Pour justifier l’envoie
d’astronautes dans l’espace, on évoque souvent l’argument voulant
que ceux-ci servent de modèles aux jeunes et qu’ils les amènent
à s’intéresser aux sciences et aux technologies. C’est mon
cas. je suis l'un de ces enfants de l'espace! |
