| . |
.
Comment Obama s’attaque
à la crise économique
Lors de sa
deuxième conférence de presse à heure de grande écoute
en moins de 65 jours de présidence – un autre contraste d‘avec George
Bush –, Barack Obama a tenu à faire le point sur comment son administration
tente de relancer l’économie. Il a donc dressé le bilan
suivant:
|
Avant
de répondre aux questions des journalistes, je désire faire
le point concernant les mesures que nous prenons pour faire passer notre
économie de la récession à une relance et, ultimement,
à la prospérité.
En premier lieu,
il importe de se rappeler que la crise actuelle ne s’est pas produite du
jour au lendemain et qu’elle n’est pas le fruit d’une décision ou
d’une action. Il a fallu de nombreuses années et plusieurs
failles pour en arriver à ce résultat. Et il faudra
plusieurs mois et une gamme de solutions différentes pour nous en
sortir. Il n’y a pas de remèdes miracles ni de solutions rapides.
C’est pourquoi nous
déployons un train de mesures conçu pour s’attaquer aux causes
de la crise sur toutes ses formes. Il s’agit de mesures pour créer
des emplois, pour aider les propriétaires fiables, pour relancer
le crédit et pour faire croître notre économie sur
le long terme. Et nous commençons à voir les signes
de progrès.
La première
mesure que nous avons mise en place est un plan de relance pour stimuler
la création d’emplois et pour mettre de l’argent dans les poches
des travailleurs. Notre plan a déjà préservé
l’emploi d’enseignants et de policiers, il crée des emplois dans
la construction pour la réfection des routes et des ponts…
Notre plan fournira une réduction d’impôts à 95% des
travailleurs et qui paraîtra sur leur chèque de paie dès
le 1er avril.
La deuxième
mesure que nous avons mise de l'avant consiste en un plan de stabilisation
du marché immobilier et pour aider les propriétaires fiables
à conserver leur maison. Ce plan est l‘une des raisons pour
lesquelles les taux hypothécaires sont pratiquement à leur
plus bas niveau historique.
Nous assistons déjà
au refinancement d’hypothèques alors même que les propriétaires
profitent des bas taux. Et chaque Américain doit savoir que jusqu’à
40% de toutes les hypothèques sont désormais admissibles
à du refinancement. Cela équivaut à une autre
baisse d’impôts. Pour la première fois depuis très
longtemps, nous commençons aussi à voir des signes d’augmentation
des ventes et de stabilisation du prix des maisons.
Le troisième
mesure de notre stratégie consiste à relancer le crédit
pour les familles et les entreprises. À cette fin, nous avons
mis en oeuvre un programme conçu pour appuyer les marchés
des prêts autos, des prêts étudiants et des prêts
pour les petites entreprises – un programme qui a déjà permis
plus de prêts au cours de la dernière semaine qu’au cours
des quatre derniers mois combinés.
Hier, le Secrétaire
[au Trésor Tim] Geithner a annoncé un nouveau plan qui combinera
les ressources du gouvernement et des investisseurs privés pour
racheter les mauvaises créances qui empêchent les banques
de se remettre à prêter. Et nous continuerons de faire
tout ce qui est nécessaire, au cours des prochaines semaines, pour
nous assurer que les banques dont dépendent les Américains
auront l’argent dont elles ont besoin pour prêter, même si
l’économie devait se détériorer.
Enfin, la portion
la plus importante de notre stratégie est de nous assurer que le
pays ne retombera pas dans un cycle de bulles spéculatives qui finissent
par éclater. Nous savons qu’une économie basée
sur la spéculation à outrance, sur le prix surévalué
des maisons et sur le crédit déraisonnable ne produit pas
de la richesse durable mais, au contraire, l’illusion d’une prospérité
qui nous met tous en danger. |
Source: «President
Obama’s News Conference», The New York Times, 24 mars
2009.
Voir aussi: Peter Baker &
Adam Nagournay, «In
a Volatile Time, Obama Strikes a New Tone for Crisis», The
New York Times, 24 mars 2009.
.
Les véritables
déficits du gouvernement du Québec
En rendant public
son budget pour l’année financière qui s’amorce le 1er avril,
la ministre des finances du Québec annonce qu’elle prévoit
«un premier budget déficitaire en dix ans». Elle
annonce ainsi un déficit de 3,9 milliards $ pour la prochaine année
et de 3,7 milliards $ pour l’année suivante.
Or, tous ces chiffres
sont faux puisque, selon les données contenues dans son Plan
budgétaire 2009-2010, en dix ans, la dette du Québec
est passée de 98 à 148 milliards $, soit une hausse de 50
milliards $. (Allô «déficit zéro»!)
C’est dire qu’en moyenne, le gouvernement enregistre un déficit
annuel de 5 milliards $ par année!
C’est ainsi que
le tableau D-3 du document montre que depuis 1998, la dette gouvernementale
a cru de la façon suivante:
 Notez le «bond»
survenu en 2008, alors que la dette grimpe d'un coup de 25 milliards $.
Celui-ci fait suite à une «réforme comptable».
Autrement dit, le gouvernement ayant sous-estimé systématiquement
ses déficits depuis dix ans, il a dû rajuster ses chiffres.
Notez le «bond»
survenu en 2008, alors que la dette grimpe d'un coup de 25 milliards $.
Celui-ci fait suite à une «réforme comptable».
Autrement dit, le gouvernement ayant sous-estimé systématiquement
ses déficits depuis dix ans, il a dû rajuster ses chiffres.
Qui plus est, le
budget prévoit une augmentation de la dette de 3,4 milliards puis
de 8,9 et de 9,9 milliards $ ces trois prochaines années… si tout
va bien.
Résultat,
le gouvernement verse des milliards en paiements d’intérêts.
C’est ainsi qu’une soixantaine de milliards $ - l’équivalent de
ses dépenses d’une année - ont été versés
de la sorte ces dix dernières années… au lieu de servir à
la santé, à l’éducation, etc. Et ça
continue puisque pour l’année en cours, il versera 6,8 milliards
$ en «pure perte» d’intérêts.
Dette totale et par habitant
|
Dette au 31 mars 2009 |
Dette par habitant |
PIB par habitant |
| . |
|
|
|
| Canada |
576,0 milliards $ |
17 291 $ |
39 237 $ |
| Ontario |
163,1 milliards $ |
12 615 $ |
45 922 $ |
| Québec |
148,0 milliards $ |
19 095 $ |
39 007 $ |
| Colombie-Britannique |
35,8 milliards $ |
8 171 $ |
56 302 $ |
| Manitoba |
14,1 milliards $ |
11 672 $ |
41 676 $ |
| Saskatchewan |
12,6 milliards $ |
12 402 $ |
59 662 $ |
| Nouvelle-Écosse |
10,9 milliards $ |
11 617 $ |
37 046 $ |
| Alberta |
10,8 milliards $ |
3 012 $ |
82 402 $ |
| Terre-Neuve |
9,8 milliards $ |
19 295 $ |
64 349 $ |
| Nouveau-Brunswick |
5,7 milliards $ |
7 627 $ |
37 789 $ |
| Île-du-Prince-Édouard |
1,0 milliards $ |
7 153 $ |
32 961 $ |
| États-Unis |
12 700 milliards $ |
42 000 $ |
48 278 $ |
|
Source; Ministère des
finances du Québec, «Plan
budgétaire 2009-2010», 19 mars 2009.
Voir aussi: Budget
de l'Ontario 2009.
.
Les Américains
moins «bornés» qu’on le pense ?
Les Américains
seraient nettement moins croyants qu’on le croit généralement,
rapporte Franck Rich dans le New York Times. «La plus
récente Enquête sur l’identité religieuse des Américains
publiée la semaine dernière, relate-t-il, constate que la
plupart des religions ont perdu du terrain depuis 1990 et que l’option
qui croit le plus rapidement est “Aucune”.» Cette option est
passée de 8 à 15%, surclassant toute les dénominations
religieuses à l’exception de catholique romaine et baptiste.
Un autre sondage réputé, l’Enquête sociale générale,
fait un constat encore plus étonnant. D’après les résultats
préliminaires publiés le mois dernier, deux fois plus d’Américains
font nettement plus confiance à la communauté scientifique
qu’aux organisations religieuses. Ces dernières «se classent
au même rang que les banques et les institutions financières
sur l’échelle de la confiance», rapporte le chroniqueur du
New
York Times.
En conséquence,
ajoute Rich, la population américaine rejetterait ce que prêchent
généralement les chefs religieux et la droite républicaine
à propos de plusieurs «enjeux moraux». Par exemple,
de récents sondages indiquent que près de 60% d’entre eux
sont d’accord avec l’abolition des restrictions sur le financement de la
recherche sur les cellules souches imposées par George Bush.
Par ailleurs, 55% ne s’objectent pas au mariage homosexuel alors que 75%
estiment que les homosexuels «affichés» devraient avoir
le droit de servir dans l‘armée.
Dans sa chronique,
Rich montre à quel point les républicains sont déconnectés
de la majorité des Américains de même qu’ils se comportent
à l’opposé de la moralité qu’ils prônent tant.
Sources: Frank Rich, «The
Culture Warriors Get Laid Off», The New York Times, 14
mars 2008 & American Religious Identification Survey, General
Social Survey.
.
|
Fin du monde à
répétition
Tout au long du 20e
siècle, on a cru voir venir la fin du monde pour l’an 2000.
D’abord pour des motifs religieux (l’Apocalypse et le retour du Christ),
puis par crainte d’un holocauste nucléaire (guerre froide entre
Américains et Soviétiques), puis en se basant sur une foule
de croyances ésotériques (grande pyramide, ère du
verseau, nouvel-âge, alignements des planètes, Nostradamus
et autres prophéties de malheur) et enfin pour des raisons environnementales
(destruction de l'écosystème). On a même craint
un terrible «bogue» pour le 1er janvier 2000.
Évidemment,
notre monde existe toujours.
Néanmoins,
en ce 21e siècle, certains continuent d'appréhender une fin
du monde, craignant principalement le réchauffement de la planète,
la fonte des glaces polaires et l‘élévation du niveau des
océans. «Gaïa est sur le point de se venger de
nous!», dit-on. (Peut-être quelques-uns voient-ils la
présente crise économique comme le début de la fin…
à moins que ce ne soit le contraire?) D’autres redoutent encore
l’Apocalypse ou se basent sur diverses croyances (notamment précolombiennes)…
D'ordinaire, la
fin du monde nous est annoncée pour dans quelques dizaines d'années.
Voilà qui est commode, puisque ceux qui le font plus tôt se
trouvent vite confronté à leurs (fausses) prophéties.
Quant aux autres, ils peuvent toujours espérer qu'on aura oublié
leurs prédictions… d’autant plus que de nouvelles fins du monde
auront entre temps été annoncées. Un bel exemple de
cela sont les prédictions des écologistes qui annonçaient,
dans les années 1970-80, divers scénarios de fin du monde
pour l’an 2000… et qui continuent de sévir aujourd’hui encore en
nous prêchant le pire pour d’ici 2050 (ou 2100, pour les plus prudents).
Le fait est:
tous
ceux et celles qui ont annoncé une fin du monde depuis des millénaires
- qu’importe sur quoi reposent leurs affirmations (science ou croyances)
- ont enregistré un taux de succès de… 0%. Z-É-R-O!
Gageons par conséquent
que la fin du monde n’aura pas lieu, une fois de plus, telle qu’annoncée.
Autrement dit, elle restera à jamais pour dans «d'ici quelques
décennies»! |
.
Le Canada « indépendant
» des États-Unis ?
Statistique Canada
rapporte que l'emploi au Canada a fléchi pour un quatrième
mois consécutif, 83,000 personnes ayant
perdu leur travail en février. Par conséquent, le taux
de chômage atteint 7,7%. En tout, ce sont 295,000
travailleurs qui ont perdu leur emploi depuis le sommet d'octobre 2008.
C’est à la
fois peu et beaucoup. C’est peu à comparer aux 2,3 millions
d’Américains qui ont subi le même sort depuis octobre.
C’est surtout «peu» si on considère que ces 83,000
pertes d’emplois sont inférieures de 35% aux 129,000
survenues en janvier. Par comparaison, aux États-Unis,
les pertes d’emplois ont cru de 9%, de 598,000
en janvier à 651,000
en février.
Voilà des
données qui étonnent énormément. En effet,
depuis le début de la crise économique, on observe que la
situation est nettement moins critique au Canada qu’aux États-Unis.
On se dit cependant qu’«on ne perd rien pour attendre», que
la crise nous rattrapera tôt ou tard et probablement plus violemment.
Or, plus le temps passe, moins ce scénario apparaît.
Est-ce à dire qu’on échappera «au gros» de la
crise? Peut-être pas, mais elle pourrait être moins rigoureuse
qu’aux États-Unis. (Il est cependant trop tôt pour tirer
une telle conclusion.)
Néanmoins,
comme le montrent les graphiques ci-contre, l’évolution de l’emploi
diffère fondamentalement entre les deux pays. Les trois premiers
graphiques montrent les gains (en bleu) et les pertes (en noir) des emplois
au Québec, en Ontario et au Canada de janvier 2008 à février
2009. Comme on le voit, le marché connaît des hauts
et des bas. Par contre, aux États-Unis (graphique du bas),
les pertes d’emplois ne cessent de croître de mois en mois, surtout
ces quatre derniers mois.
On continue ainsi
d’observer que les taux de chômage demeurent inférieurs au
Canada qu’aux États-Unis, de même qu’au Québec par
rapport à l’Ontario (tableau ci-dessous). Voilà une
autre situation étonnante. |
|
Travail et chômage, février
2009
|
Québec |
O/Q |
Ontario |
C/O |
Canada |
E/C |
États-Unis |
| Population
adulte |
6 411 200 |
1,65 |
10 604 600 |
2,56 |
27 161 200 |
8,65 |
234 913 000 |
| Population
active |
4 169 300 |
1,72 |
7 185 600 |
2,55 |
18 315 200 |
8,42 |
152 214 000 |
|
Emploi |
3 840 100 |
1,71 |
6 559 900 |
2,58 |
16 889 400 |
8,39 |
141 748 000 |
|
Temps plein |
3 114 200 |
1,71 |
5 316 700 |
2,58 |
13 696 900 |
|
n/d |
|
Temps partiel |
725 900 |
1,71 |
1 142 200 |
2,58 |
3 202 500 |
|
n/d |
|
Chômage |
329 200 |
1,90 |
626 700 |
2,26 |
1 415 900 |
8,81 |
12 407 000 |
| . |
|
|
|
|
|
|
|
| Taux d'activité |
65,0 % |
|
67,8 % |
|
67,4 % |
|
65,7 % |
| Taux de
chômage |
7,9 % |
|
8,7 % |
|
7,7 % |
|
8,1 % |
| Taux d'emploi |
59,9 % |
|
61,3 % |
|
62,2 % |
|
60.3 % |
|
On considère
pourtant que notre sort économique est intimement lié à
celui des États-Unis, étant donné que la grande majorité
de ce que nous produisons est achetée par nos voisins. On
s’attend donc à ce que nous soyons frappés de plein fouet
par toute récession américaine. Or, cela ne semble
pas être le cas cette fois-ci (on observe plutot un «ralentissement»
de notre économie).
Que se passe-t-il
donc?
Est-ce à
dire que l’économie canadienne ne marcherait plus au pas de celle
de nos voisins? Ce serait étonnant, bien que c’est ce que
les chiffres de l’emploi tendent à indiquer.
Comment expliquer un tel
désarrimage entre les deux économies? Les faits que
notre système bancaire n’a pas commis les excès de l‘américain
(en prêtant à tout vent), que nous, comme consommateurs, ne
nous soyons pas lancés dans une boulimie de folles dépenses
à crédit et que, d’une façon générale,
notre société ne repose pas autant sur les profits et l’appât
du gain à tout prix - la cupidité - expliquent peut-être
qu’au bout du compte, nous vivons dans une société plus saine
que celle des États-Unis. Peut-être…
.
| Note: |
Le trois facteurs O/Q, C/O et É/C permettent de
comparer respectivement la situation du Québec et de l’Ontario,
celle de l’Ontario et du Canada et celle du Canada et des États-Unis.
Ainsi, la population adulte
de l’Ontario est 1,65 fois plus grande que celle du Québec. En outre,
la population active y est encore plus grande (1,72 fois), c’est-à-dire
que, toute proportion gardée, plus d’adultes sont sur le
marché du travail en Ontario qu’au Québec. (Les deux provinces
seraient à égalité si tous les facteurs étaient
à 1,65.) De même, il y a un plus grand nombre de personnes
en emploi (1,71 fois) mais encore davantage de chômeurs (1,90 fois…
c'est-à-dire qu'il y a presque deux fois plus de chômeurs
en Ontario qu'au Québec).
Si on compare le Canada aux
États-Unis, on observe que la population adulte américaine
est 8,65 fois plus élevée que celle du Canada. Par
contre, le nombre de travailleurs est plus petit (8,42 fois), alors que
le nombre de chômeurs est plus élevé (8,81 fois). |
Source: Statistique Canada, «Enquête
sur la population active, Février 2009», Le Quotidien,
13 mars 2009.
.
|
Internet : que faisions-nous
avant
?
Il y a vingt ans,
des informaticiens ont imaginé le World Wide Web (www), autrement
dit: le réseau Internet. On rapporte que, le 13 mars 1989*,
un chercheur britannique en physique, Tim
Berners-Lee, a présenté à ses collègues
du Conseil européen pour la recherche nucléaire un projet
visant à permettre aux milliers de scientifiques collaborant au
CERN de rester en contact et de partager par ordinateurs les résultats
de leurs travaux. C’est ainsi qu’est né le Web. Ce nouveau
mode de communication a été mis à la disposition du
public à partir de 1991.
C’est ainsi qu’il
y a vingt ans, sans qu’on le sache, s’amorçait l’une des plus fulgurantes
révolutions planétaires. En moins de dix ans, l’outil
de communication Internet – qui permet entre autres les échanges
par courriel, l’accès au bout des doigts de l’information sur tout
et pour tous, tout en révolutionnant maintes pratiques du travail
– s’est imposé. On en arrive même à se demander
ce qu’était notre vie avant Internet.
Aurait-on dû en débattre
?
Internet est étonnant
à biens des égards. D’une part, il s’agit de l’une
des révolutions les plus marquantes de la vie moderne mais que,
pourtant, personne n’avait vu venir. La rapidité avec laquelle
s’est imposé Internet défierait même tout scénario
de science-fiction.
Internet met aussi
en valeur ce qu’il y a de meilleur chez l’humain, en permettant notamment
de créer mains réseaux de contacts et de solidarité
à l’échelle planétaire et en favorisant le partage
de la meilleure information (Wikipédia et journaux en ligne).
Évidemment, il permet aussi «le pire» (cybercriminalité
et pornographie juvénile), ce que ne manquent pas de rapporter les
médias.
Le fait qu’Internet
soit apparu de façon si inattendue amène à se demander
ce qu’il serait arrivé s’il en avait été autrement.
Dans les années
1970, nous avons vu venir la révolution informatique, le fait que
les ordinateurs allaient bientôt «envahir» nos vies.
Plusieurs s’inquiétaient fortement de ce que ceux-ci créeraient
beaucoup de chômage – les machines remplaçant l’homme – tout
en permettant à nos gouvernements de nous surveiller constamment
(syndrome du Big Brother). D’autres imaginaient qu’ils allaient
tout bonnement nous compliquer la vie: le syndrome dit I.B.M., pour It’s
Better Manually («Vaut mieux tout faire à la main»).
Heureusement que la révolution informatique n’a pu être arrêtée.
Imaginons maintenant
si, fin des années 1980-début des années 1990, on
avait pu débattre de la pertinence d’établir un réseau
planétaire d’échanges comme Internet. Nul doute qu’une
pléthore de «prophètes de malheur» se serait
élevée pour s’y opposer, prétextant mille et un périls
(certains véritables, d’autres chimériques).
Or, devant les interminables
débats publics qui sévissent un peu partout dans notre société
(et qui bloquent maints projets, mème bons), on peut supposer que
si la création d’un réseau aussi polyvalent, puissant et
soumis à aucun contrôle qu’Internet avait fait l’objet d’un
questionnement préalable, on serait encore à en discuter
et que, par conséquent, il n’existerait pas. La société
s’en porterait-elle mieux ainsi?
Prochaine «révolution»
en préparation ?
Ce vingtième
anniversaire est d’autre part intéressant du fait qu’il nous rappelle
à quel point d’importants progrès peuvent surgir inopinément.
Ainsi, se pourrait-il, en cette période de tourments (qui favorise
dit-on l’innovation et la créativité) que quelque part soit
en train de naître la prochaine «révolution bienveillante»
qui bouleversera nos vies d'ici dix ou quinze ans?
Il y a en ce moment
des «petits génies» à l’œuvre… peut-être
même certains qui ne se doutent pas de la révolution qu’ils
pourraient déclencher (comme Tim Berners-Lee… devenu Sir Timothy
John Berners-Lee).
| * |
Peut-être vous souvenez-vous de cette journée particulière,
puisque ce 13 mars, le Québec a été paralysé
par une panne d’électricité généralisée.
Plusieurs lignes de haute tension reliant Montréal et la Baie-James
sont «tombées», victimes d’un puissant orage magnétique
(une explosion solaire qui vient perturber le champs magnétique
terrestre). Voir les explications de Michel Morin, «Le
Québec dans le noir», Société Radio-Canada. |
|
.
Indulgence pour la richesse
des « riches »
Bob Herbert rapporte
dans le New York Times qu’entre 1980 et 2005, la taille de l’économie
américaine a plus que doublé. Pourtant, durant cette
période, le revenu moyen pour l’immense majorité des Américains
a… diminué!
«Aussi incroyable
que cela puisse paraître, écrit-il, l’année 1973 est
celle où les revenus ont été les plus élevés
pour 90% des Américains.» Le revenu moyen par travailleur
(ajusté selon l‘inflation) était alors de 33,000
dollars américains, soit 4,000$ de
plus qu’en 2005.
Ces données
s'assimilent à celles publiées en mai dernier par Statistique
Canada à l'effet que les gains pour les travailleurs canadiens ont
légèrement progressé pour passer de 41,348$
en 1980 à 41,401$ en 2005 (en dollars
canadiens constants de 2005). Surtout, Statistique Canada révélait
que les gains se sont accrus à l'échelon supérieur
des emplois, ont stagné à l'échelon moyen et ont diminué
à l'échelon inférieur. C’est ainsi qu’entre
1980 et 2005, le revenus du 20% des travailleurs les mieux rémunérés
a progressé de 16,4%, alors que celui du 20% des moins bien rémunérés
a chuté de 20,6%. Quant au 20% de la tranche moyenne – «la
classe moyenne» pourrait-on dire -, leurs revenus ont augmenté…
de 0,1%.
Comment se
fait-il que les revenus de l’immense majorité des travailleurs n’ont
pas suivi l’extraordinaire progression de l’économie ?, se demande
le chroniqueur du New York Times.
En guise de réponse,
il cite Jared Bernstein, économiste et depuis peu conseiller auprès
du vice-président Joe Biden, qui écrivait dans un livre:
«L’économie a été détournée par
les riches et puissants et transformée en un outil utilisé
contre le reste d’entre nous.»
Herbert dénonce
l’idéologie républicaine au pouvoir pour l’essentiel des
trente dernières années et qui préconise des baisses
d’impôts pour les plus riches, la déréglementation
des marchés et la réduction du «Big Government»
pour laisser davantage d’argent dans les poches des «contribuables»
afin, dit-on, que la richesse ainsi dégagée «descende»
dans le reste de l’économie. (Évidemment, les plus riches
qui, en principe paient le plus d’impôts, sont les premiers bénéficières
de telles mesures.)
«Les travailleurs
se sont fait vendre l’idée que ces mesures étaient bonnes
pour eux, écrit Herbert. Ils en sont venus à penser
que c’était une merveilleuse idée que de confier leur part
de l’enrichissement collectif à ceux qui sont déjà
fabuleusement riches.»
On pourrait se demander
pourquoi cette idéologie est si populaire, même ici.
Pense-t-on que «les riches» savent mieux que nous dépenser
les gains générés par la collectivité?
Peut-être
sommes-nous conditionnés à admirer «les riches et célèbres»,
à penser qu’ils méritent de conserver la richesse qu’ils
s’approprient? (Autrement, comment accepter l’idée
que n’importe quel joueur de hockey gagne des millions, de même qu’une
certaine classe de p.d.g.?) Peut-être est-on tout aussi disposé
à ce que «les riches» ne paient pas trop d’impôts
en pensant au jour où nous aussi serons «riches».
Ne se sent-on pas naturellement vexé par l’idée d’avoir à
remettre 40% de nos revenus le jour où nous gagnerons 100,000$
ou plus? En attendant, on achète l’idée qu’«on»
paie trop d’impôts et que ceux-ci doivent être diminués
(au profit des plus riches).
Sources: Bob Herbert, «Reviving
the Dream», The New York Times, 9 mars 2009 ; Statistique
Canada, «Recensement
de 2006 : Gains, revenus et coûts d'habitation», 1er mai
2008.
.
L’un des grands tournants
de l'Histoire ?
«Et si la crise
économique de 2008 représentait quelque chose de nettement
plus fondamental qu’une profonde récession?, pose Thomas Friedman
dans le New York Times. Et si elle nous disait que la mécanique
de croissance perpétuelle que nous avons institué ces cinquante
dernières années était tout simplement insoutenable
économiquement et écologiquement et qu'en 2008, nous avons
frappé un mur?»
«Peut-être
un jour considérerons-nous 2008 comme un point tournant dans l’histoire
de l’humanité? Nos enfants et petits-enfants nous demanderont
peut-être: “Comment c’était avant? Que faisiez-vous
lorsque le système s’est effondré? À quoi pensiez-vous
et comment avez-vous réagi?”»
Pour ma part, je
dirai que c’est entre autres pour répondre à ce genre de
questions que je tiens à jour cette chronique. Qui sait le
chemin que nous parcourrons d'ici cinq à dix ans et, surtout, où
nous aboutirons?!
D’après: Thomas Friedman,
«The
Inflection Is Near?», The New York Times, 7 mars 2009.
.
Donnera-t-on à
Obama le temps
de « faire des miracles
» ?
Dans une chronique
intitulée «Les miracles demandent du temps», Bob Herbert
s’inquiète de ce que: «Barack Obama n’est président
que depuis six semaines que déjà on assiste à un étonnant
déferlement de hauts cris, de colère et même de déception
parce qu’il n’a pas encore su résoudre les problèmes de l’économie
américaine, parce qu’il ne nous a pas non plus délivré
des conséquences désastreuses résultant des folles
idées des conservateurs de droite et des années de mauvaise
gestion par les radicaux républicains.»
«On lui reproche
– selon l’angle d’où on le critique – le fait que les marchés
financiers continuent de chuter, de ne pas agir assez rapidement pour remettre
à flots l’industrie financière au bord du précipice,
pour n’avoir pas encore arrêté l’hémorragie des saisies
de maison, pour chercher à procurer une assurance-santé aux
millions d’Américains qui n’en ont pas, pour engendrer le plus grand
déficit budgétaire alors qu’il combat la plus grave crise
économique depuis la Seconde guerre mondiale…»
Évidemment,
souligne Herbert, il faudra du temps, beaucoup de temps, pour remédier
aux décennies d'incurie républicaine, mais sera-t-on assez
patient pour le lui en donner?
D'après Bob Herbert,
«Miracles
Take Time», The New York Times, 6 mars 2009.
.
À la découverte
des premières Terres
 La NASA vient de lancer l’un des plus importants instruments scientifiques
de tous les temps – Kepler – un télescope spatial aussi remarquable
qu’Hubble. Si tout va bien, celui-ci repérera les premières
planètes semblables à la Terre gravitant autour d’étoiles
se trouvant à quelques années-lumière de nous.
Il répondra ainsi à l’une de nos grandes interrogations:
des planètes comme la nôtre abondent-elles dans notre galaxie
ou sont-elles plutôt rares?
La NASA vient de lancer l’un des plus importants instruments scientifiques
de tous les temps – Kepler – un télescope spatial aussi remarquable
qu’Hubble. Si tout va bien, celui-ci repérera les premières
planètes semblables à la Terre gravitant autour d’étoiles
se trouvant à quelques années-lumière de nous.
Il répondra ainsi à l’une de nos grandes interrogations:
des planètes comme la nôtre abondent-elles dans notre galaxie
ou sont-elles plutôt rares?
Au cours des
douze dernières années, nous avons découvert trois
cents planètes autour d’étoiles voisines. Toutefois,
à cause des techniques employées, on n'a découvert
que d’immenses boules de gaz semblables à Jupiter et où,
d’après nos connaissances, la vie ne peut exister. On n’a
jusqu’à présent jamais repéré une petite planète
rocheuse comme la nôtre.
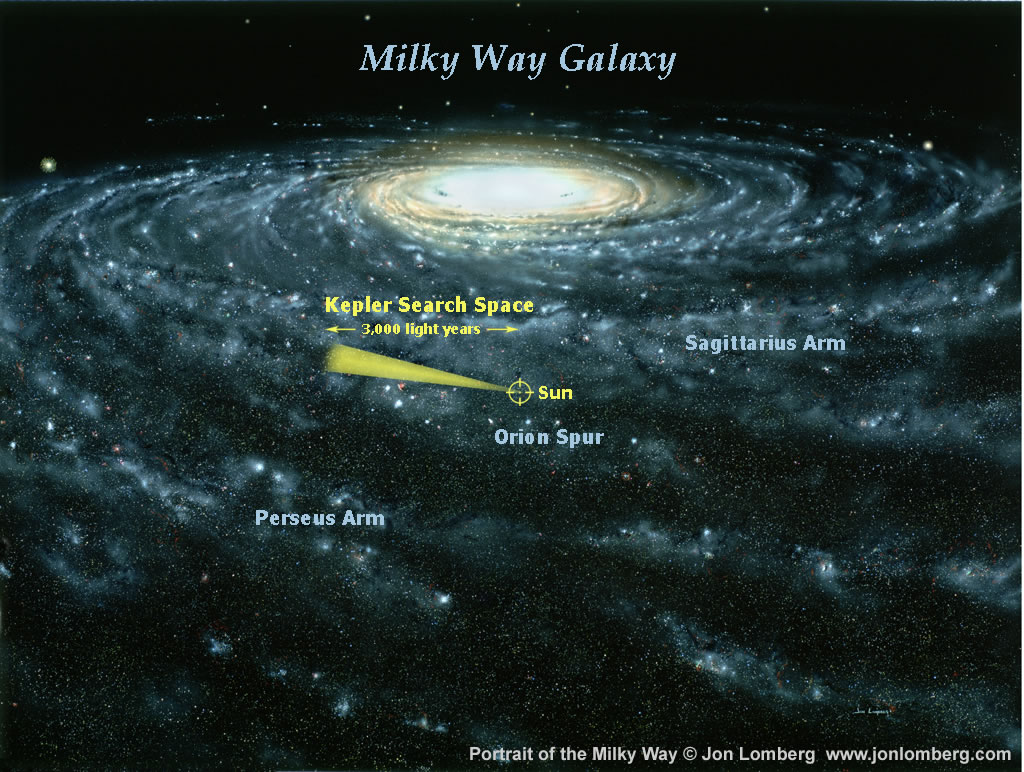 Au cours des trois prochaines années, Kepler procédera à
un «sondage» en scrutant une population de 100,000
étoiles afin de déterminer quelle proportion d’entre elles
possède des petites planètes. Tel qu’illustré
ci-contre, il scrutera une minuscule portion de notre galaxie, en direction
de la constellation du Signe, comprise entre ici et 3,000
années-lumière. En sondant ainsi le un deux-millionnièmes
des étoiles qui forment notre galaxie, Kepler découvrira-t-il
une ou des milliers de Terres… ou toute autre chose?
Au cours des trois prochaines années, Kepler procédera à
un «sondage» en scrutant une population de 100,000
étoiles afin de déterminer quelle proportion d’entre elles
possède des petites planètes. Tel qu’illustré
ci-contre, il scrutera une minuscule portion de notre galaxie, en direction
de la constellation du Signe, comprise entre ici et 3,000
années-lumière. En sondant ainsi le un deux-millionnièmes
des étoiles qui forment notre galaxie, Kepler découvrira-t-il
une ou des milliers de Terres… ou toute autre chose?
Sa tâche équivaut
à tenter d'observer le passage d’un insecte devant les phares d’une
automobile située à des kilomètres. C’est-à-dire
que lorsqu’une planète passe devant son étoile, elle fait
légèrement diminuer son éclat (de 0,001%). Kepler
cherchera donc à mesurer cette diminution d’éclat.
Il n’a cependant pas la capacité de photographier les planètes
qu’il détectera, de sorte qu’on ne verra pas ces Terres. Il
ne possède pas non plus la capacité de déterminer
si certaines recèlent de la vie.
|
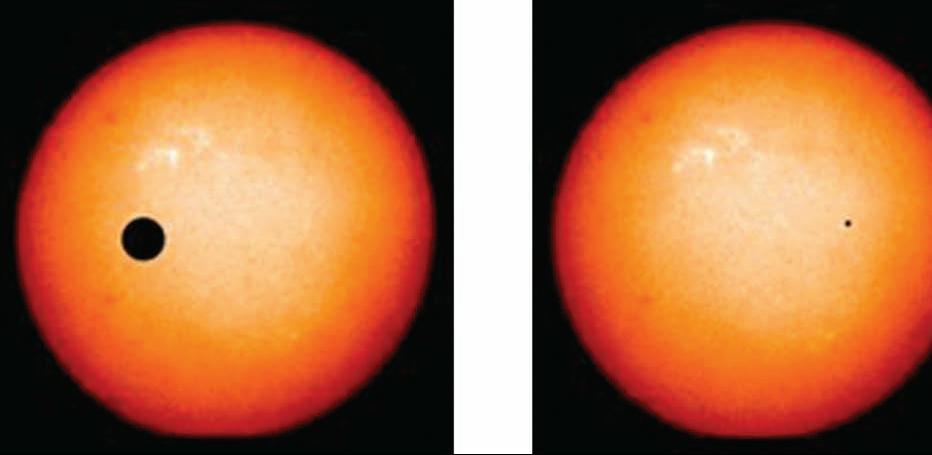 |
|
|
Lorsqu’une planète passe
devant son étoile, elle jette une «ombre» correspondant
à sa taille. L’illustration de gauche représente le
passage d’une Jupiter devant le Soleil, alors que celle de droite montre
une Terre. Notons que Kepler ne verra pas les astres comme nous le
montrent ces illustrations, mais mesurera plutôt la diminution de
l’éclat de l’étoile causée par le passage de la planète.
Qui plus est, alors que ces illustrations ne sont qu’à un mètre
de vous, dans le cas de Kepler, elles devraient être placées
à des kilomètres! |
|
La facture de la
mission Kepler s’élève à 600 millions $us, ce qui
pourrait sembler une dépense extravagante en ces temps de crise
économique. Toutefois, si on considere que le nombre de travailleurs
américains (qui défraient la facture) s’élève
à 150 millions de personnes, c’est comme si chacun d’entre eux avait
déboursé 4$ pour cette quête scientifique. Notons
que cette somme «astronomique» n’a pas été dépensée
«dans l’espace» mais bien en salaires versés à
deux mille ingénieurs, scientifiques et techniciens au cours des
cinq dernières années.
Ressources: Site
web de la mission Kepler (NASA); Press
Kit de la misson Kepler.
Voir aussi mon livre Comment
savoir si nous sommes seuls dans L'Univers ?
.
La Crise s’accentue
L’une des meilleures
façons de voir où en est la crise économique est de
suivre l’évolution du nombre de personnes qui perdent leur emploi.
Cela nous donne non seulement une idée du nombre de personnes qui
sont directement affligées par la crise, mais également comment
se comporte l’économie en général; plus le nombre
de sans-emploi s’accroît, plus l’économie se contracte, et
plus l’économie se contracte, plus de personnes perdent leur emploi…
Le premier signe d'une reprise économique sera de sortir de cette
spirale infernale. Or, nous n'en sommes vraiment pas là.
En effet, les données
sur l‘emploi aux États-Unis – l’épicentre de la crise - indiquent
que la spirale du chômage, loin de s’estomper, s’accentue au contraire.
En février seulement, 651,000 Américains
ont perdu leur emploi, soit 9% de plus qu’en janvier (598,000)
et davantage qu’en décembre (524,000)
et en novembre (533,000). Depuis le
début de la récession (décembre 2007), c’est plus
de 3 millions d’Américains qui ont rejoint les 9 millions déjà
sans-emplois.
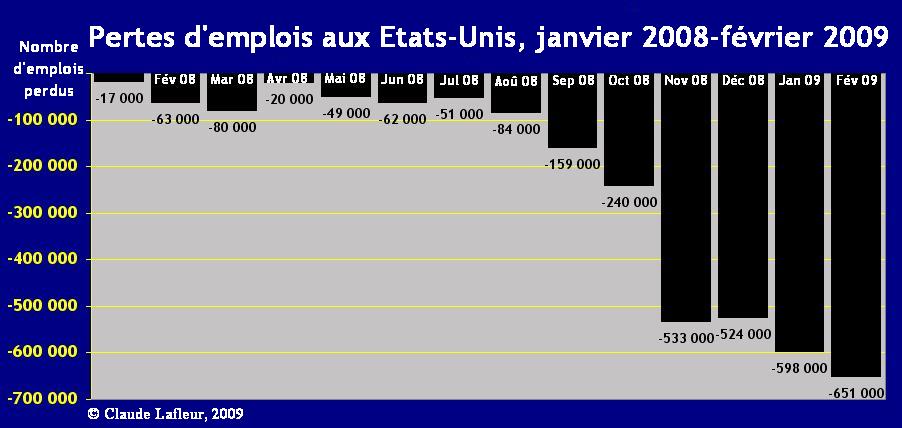
Depuis plus d’un an, on assiste
à d’importantes pertes d’emplois aux Etats-Unis; en
janvier 2008, ces pertes se
chiffraient dans les 17,000, aujourd’hui,
dans les 650,000.
C’est ainsi qu’en
l’espace d’un mois, le taux de chômage a bondi de 7,6 à 8,1%,
atteignant son plus haut niveau en 25 ans. C’est même le plus grand
nombre de personnes sans emplois depuis au moins quinze semaines comptabilisé
depuis le Seconde guerre mondiale. De telles données sont
d’autant plus significatives que les analystes s’attendaient, il y a quelques
semaines à peine, à ce que le taux de chômage atteigne
9% en fin d’année seulement, Or, au rythme de 500 à
600 mille pertes d’emplois par mois, ce cap sera franchi dès le
mois de mai, pour atteindre les 12% en fin d’année.
Qui plus est, si
on ajoute au 12,5 millions d’Américains en chômage tous ceux
et celles qui ont cessé de chercher du travail, le pourcentage grimpe
déjà à 9,3%. Si on ajoute ceux qui travaillent
à temps partiel faute de ne pouvoir occuper un emploi à temps
plein, la proportion des «mal employés» frôle
les 15%.
Toutes ces données
indiquent clairement que la crise économique est loin de se
résorber, puisque les pertes d’emplois continuent d’augmentera aux
États-Unis. Reste à voir ce qui s’est passé
chez nous en février - ce que nous saurons la semaine prochaine.
Sources: Bureau of Labor Statistics,
«Employment
Situation Summary», 6 March 2009 ; Peter Goodman & Jack Healy,
«Continuing
Job Losses May Signal Broad Economic Shift», The New York
Times, 6 mars 2009.
.
Veut-on vraiment savoir
ce que nous réserve l’avenir ?
Tout le monde (ou presque) a une série
de questions pressantes en tête: combien de temps durera la crise
actuelle? À quel point sera-t-elle sévère et
comment, ou jusqu’à quel point, serons-nous affectés (personnellement
et collectivement)?
On cherche évidemment tous la réponse
à ces questions. Les médias font d’ailleurs grand état
de l’opinion des économistes et autres experts dans l’espoir qu’ils
sauront nous guider. L’avenir nous inquiète, y'a de quoi!
Malheureusement, personne ne peut réellement
assouvir notre quête. C’est pourquoi il y a tant de réponses
divergentes et contradictoires. Au mieux, certains essaient de nous
rassurer en disant quelque chose comme «il se pourrait bien que…»
en s’empressant d’ajouter «… à moins que…»
Peut-être la meilleure façon de
calmer nos angoisses est de prendre un peu de recul et de «remonter
le temps» pour se donner une perspective.
Revenons donc à il y a un an, au printemps
2008, c’est-à-dire avant que ne suirvienne l’implosion des subprimes
hypothécaires qui a tout déclenché. Rappelez-vous:
les prix du pétrole étaient à leurs plus hauts – à
près de 1,50 $ le litre ou a 140 $ le baril -, alors que les bourses
frôlaient des sommets. (Époque qui paraît déjà
bien lointaine, n'est-ce pas?) Évidemment, on était
loin de se douter de ce qui nous attendait à peine quelques mois
plus tard (même si certains signes avant-coureurs apparaissaient
déjà clairement).
Imaginons qu’un économiste, ou tout
autre expert, nous ait annoncé (sans l’ombre d’un doute) ce qui
allait se produire. Or, si on l’avait cru, cela aurait causé
une panique… qui aurait provoqué une crise encore plus sévère.
Imaginez simplement que devant l’imminence de l’effondrement des cours
boursiers, si «tout le monde» avait rapidement retiré
ses épargnes… Connaître l’avenir n’aurait fait qu’aggraver
les choses.
Ou, en supposant qu’une telle annonce n’aurait
pas provoqué de panique tout en ne changeant rien au sort économique
qui nous était réservé, aurait-on été
plus rassuré de connaître ainsi l’avenir?
Prenons un second exemple qui fournit une meilleure
perspective encore: le krach boursier de 1929 et la Grande dépression
des années 1930 (à laquelle se comparerait de plus en plus
la crise actuelle).
Imaginez qu’à l'époque, un visionnaire
quelconque nous ait raconté qu’au lendemain de l'effondrement de
la bourse, une dizaine d’années d’une crise économique épouventable
s’achèverait par cinq années d’une terrible guerre mondiale,
le tout débouchant heureusement sur une formidable période
de prospérité (le baby-boom). Aurait-on vraiment été
rassuré d’apprendre qu’après quinze années d’«enfer»
et d’épreuves, on finirait par bien s’en sortir?
Évidemment, diront certains, si on connaissait
l’avenir, on pourrait changer certains paramètres afin d’éviter
les catastrophes. Mais ce faisant, on se retrouverait devant un avenir
tout aussi incertain. (On ne s’en sort donc pas!)
Est-ce à dire qu’il vaut mieux demeurer
dans l’ignorance? Oui car, autrement, ce que nous vivrions serait
encore plus pénible. Pensez simplement aux grandes épreuves
que la vie vous a imposé à ce jour – peines d’amour et séparations,
décès, revers et pertes d’emploi, etc. – et que vous avez
fini par traverser de toute façon. Aurait-il mieux valu que
vous les connaissiez d’avance? Vaut-il vraiment mieux savoir ce que
nous réservent les prochains mois, les prochaines années?
En vérité, ce qui est intéressant,
c’est de connaître «la fin de l’histoire» une fois qu’on
l’a traversée. Mais non avant. C’est un peu comme lire
un bon livre, une histoire à suspens captivante. En connaître
la fin dès le départ gâcherait une bonne part du plaisir,
n’est-ce pas? (Il y a pourtant des gens qui commencent un livre par
le dernier chapitre… Avez-vous déjà tenté l’expérience?)
Bien sûr, il demeure difficile de résister
à la tentation de connaître l‘avenir – si c’était possible.
C’est pourquoi les économistes, les analystes et les diseurs de
bonne aventure sont si en demande.
Imaginons donc le scénario suivant,
assez vraisemblable.
La crise économique sera longue et
ardue: elle durera un bon trois ans, le taux de chômage doublera
et une multitude d’entreprises et de commerces disparaîtront. Tout
le monde sera touché - de près (en perdant son emploi ou
en subissant d’importantes pertes financières) ou de loin (des gens
dans votre entourage subissant ce triste sort).
Il faudra ensuite des années pour que
l’économie revienne à des niveaux d’activité comparables
à ceux que nous venons de connaître. Les indicateurs
économiques de 2015 pourraient ressembler à ceux de 2005.
Paradoxalement, la crise de la main-d’œuvre
qu’on appréhendait tant – les baby-boomers prenant leur retraite
en si grand nombre que les jeunes générations ne pourraient
suffire à les remplacer – sera tempérée par la contraction
de l’économie. Ce phénomène nous ramènera heureusement
plus rapidement vers le «plein emploi».
Plus rassuré, maintenant?! |
.
|
Je suis inquiet. Nous venons
d’élire un jeune président très talentueux qui a de
bonnes idées pour faire progresser le pays, pour étendre
les soins de santé à davantage de personnes, pour rendre
nos lois de l’impôt plus équitables et pour amorcer une révolution
industrielle verte. Mais je crains que son premier mandat soit accaparé
par Citigroup, A.I.G., Bank of America, Merrill Lynch et la bulle du crédit
et des prêts hypothécaires que nous avons gonflée ces
vingt dernières années. |
|
- Thomas Friedman, 3 mars 2009 |
.
Pourquoi faut-il secourir
les banques
(bien malgré nous)
?
La crise économique
est plus complexe que tout ce qu’on peut imaginer, écrit Thomas
Friedman, chroniqueur au New York Times.
Nous ressortons
de vingt années de fêtes à crédit. Comme pays,
trop d’entre nous avons cessé de fabriquer des biens pour plutôt
faire de l’argent avec de l’argent. Comme citoyens, nous avons cru
réaliser des gains grâce à l’appréciation de
la valeur de nos propriétés et nous avons utilisé
ces gains pour acheter à crédit des télés à
écran plat fabriquées en Chine. Les banquiers faisaient
des gains en créant des montages financiers complexes et en utilisant
des mécanismes de levier pour que de plus en plus de consommateurs
entrent dans le jeu du crédit.
Lorsque cette
gigantesque bulle a éclaté, elle a créé un
immense cratère si profond que nous ne pouvons en voir le fond.
Celui-ci est le produit de deux excès qui sont liés.
Certaines banques
sont en difficulté à cause des titres hypothécaires
en subprime
qu’elles ont dans leurs livres et qui ne valent plus que 20% à cause
des non-remboursements fréquents. Plusieurs autres banques
– celles qui ont le plus recouru aux leviers (comme Citigroup et Bank of
America) - sont en difficulté parce que les prêts qu’elles
ont dans leurs livres (prêts auto, prêts hypothécaires
commerciaux, prêts sur carte de crédit, prêts d'affaires)
ne peuvent plus être remboursés. La plupart des grandes
banques n’ont pas encore rayé de leurs livres ces prêts car,
si elles le faisaient, elles deviendraient insolvables.
Pour résoudre
la crise des prêts hypothécaires, il faudra des milliards
$. Pour résoudre celle des autres prêts, il faudra des
billions $.
Sortir d’un cratère
aussi profond sera extrêmement périlleux. Toute action
que nous prendrons risque fort de créer d’autres problèmes
dont on ne peut saisir toutes les ramifications.
Nous devons créer
une «mauvaise banque» qui achètera et conservera les
valeurs toxiques, ou faire en sorte que le gouvernement en achète
une bonne portion afin de créer un marché. Cela nous
obligera à secourir des banques qui ne le méritent pas.
Mais c’est le prix à payer pour éviter que tout le système
ne s’écroule…
D'après: Thomas Friedman,
«Obama’s
Ball and Chain», The New York Times, 3 mars 2009.
.
Les coûts de la
guerre en Irak
Lorsqu’on parle des
coûts de la guerre en Irak, on cite généralement les
sommes mirobolantes qui y ont été englouties (des centaines
de milliards $) ainsi que les 4,252
soldats américains qui, à ce jour, y ont perdu la vie.
Cependant, il y
a bien d’autres coûts. Par exemple, Bob
Herbert cite une récente étude de la RAND Corporation
qui évalue que 300,000 soldats américains
souffrent à présent de désordres post-traumatiques
et de dépression, alors que 320,000
autres sont victimes de traumatismes au cerveau. Au bout du compte,
un nombre croissant d'entre eux finissent par se suicider (128 en 2008).
À cela s’ajoutent
les 31,089
soldats qui «officiellement» ont été blessés
(alors qu'on estime ce nombre à plus de 100,000).
Sans compter les 100,000
civils irakiens qui ont perdu la vie, plus le nombre incalculable de ceux
qui ont été blessés et les autres qui ont, d’une façon
ou d’une autre, «tout perdu».
Dire que les attentats
du 11 septembre 2001, au nom desquels l’invasion de l’Irak a été
ordonnée par l’administration Bush, n’ont fait que 2,973
victimes directes.
Sources et ressources: Bob Herbert,
«Wars,
Endless Wars», The New York Times, 2 mars 2009 ; «Casualties
in Iraq» ; «Irak
Body Count» ; Wikipédia, «Attentats
du 11 septembre 2001» ; «Le
coût de la guerre : 46 400 $ par famille», Le Carnet
2007, 13 novembre 2007.
.
Frappés de plein
fouet par la récession
Statistique Canada
révèle que, ces trois derniers mois, l'économie canadienne
s’est contractée de 3,4% sur une base annuelle. «Le produit
intérieur brut (PIB) a reculé de 0,8% au quatrième
trimestre 2008, s'étant replié progressivement chaque mois,
écrit-on. Il s'agit de la plus forte baisse trimestrielle
enregistrée depuis 1991. Des baisses dans les exportations, l'investissement
en capital et les dépenses personnelles ont toutes contribué
à la contraction de l'économie.»
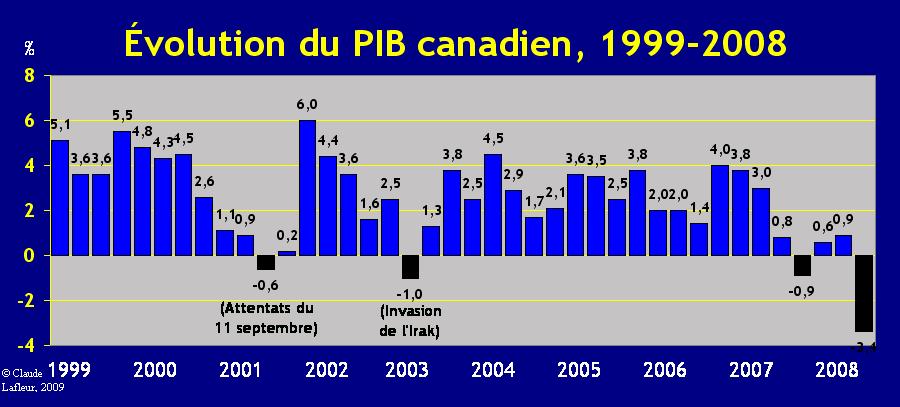
Ce graphique illustre
la «gravité» de ce qui se passe. Il retrace l’évolution
du PIB canadien d’un trimestre à l’autre depuis dix ans. Généralement,
celui-ci a eu tendance à croître à chaque trimestre
(de 3% en moyenne). Tel n’est cependant plus le cas depuis les six derniers
trimestres, particulièrement lors du dernier (enregistrant une chute
spectaculaire de –3,4%).
«On peut se
consoler en remarquant que c'est mieux (ou "moins pire") que les États-Unis
(-6,2%), l'Union européenne (-5,9%) ou même le Japon (-12,7%)»,
commente Claude Picher, chroniqueur à La Presse.
Toutefois, on enregistre
des reculs sur presque tous les fronts: ventes au détail, exportations,
bâtiment, bénéfices des entreprises, etc. «C'est
un peu comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur de l'économie
canadienne après octobre», rapporte le journaliste Stéphane
Paquet, en citant les propos d’Avery Shenfeld, économiste senior
à la CIBC Marchés mondiaux.
En fait, les données
indiquant que plus 2008 progressait, plus l'économie ralentissait,
la majorité des économistes s'attend à ce que 2009
soit plus difficile encore. Le trimestre actuel (janvier-mars) pourrait
même être le pire des cinquante dernières années!
«L'enquête
trimestrielle de Statistique Canada nous dresse un portrait de l'économie
pour une période donnée, poursuit Claude Picher. Elle nous
apprend que les Canadiens viennent de vivre trois mois difficiles. Mais
qu'en est-il de l'avenir? Qu'est-ce qui nous attend en 2009?
Il y a les optimistes qui pensent que la crise sera relativement courte,
et les pessimistes qui s'attendent à une longue période de
morosité. Le hic, c'est que les deux camps avancent d'excellents
arguments.»
Néanmoins,
selon l'Association des économistes québécois – qui
regroupe cinq cents économistes oeuvrant un peu partout dans  notre
économie -, la situation du Québec risque fort de se détériorer
au cours des prochains mois. «82% des membres sont d'avis que l'activité
économique pourrait se détériorer au cours des six
prochains mois», rapporte l’ASDEQ après avoir sondé
150 de ses membres. notre
économie -, la situation du Québec risque fort de se détériorer
au cours des prochains mois. «82% des membres sont d'avis que l'activité
économique pourrait se détériorer au cours des six
prochains mois», rapporte l’ASDEQ après avoir sondé
150 de ses membres.
«Les Canadiens
auront besoin d'une reprise aux États-Unis avant d'espérer
une amélioration de la situation économique de ce côté-ci
de la frontière», rappelle l’économiste Shenfeld.
Or, comme on l'observe jour après jour, la crise ne cesse de s’amplifier
aux États-Unis, telle que l’illustre la chute de l’indice Dow Jones
ces derniers jours (graphique ci-contre).
D’après : Statistique
Canada, «Comptes
économiques canadiens», Le Quotidien, 2 mars 2009
; Claude Picher, «Le Pire est à venir» et Stéphane
Paquet, «L’économie canadienne en récession»,
La
Presse Affaires, 3 mars 2009 ; Association des économistes québécois,
Résultat
du deuxième sondage, 2 mars 2009.
.
Vivons-nous une «
Grande dépression » ?
Peut-on faire le
parallèle entre la Grande dépression des années 1930
et la crise économique que nous subissons, a demandé l’animateur
Joël Le Bigot à Carl
Grenier, professeur au département de science politique de l'Université
Laval, qui observe de près ce qui se passe aux États-Unis.
Celui-ci a répondu
qu’on voit «peut-être» de plus en plus de parallèles
entre les deux crises, bien que celles-ci diffèrent. «Je
dis “peut-être” parce que les diagnostics ne sont pas encore très
clairs, dit-il. Mais l’ampleur de la crise dépasse carrément
tout ce qu’on a vu [ces dernières décennies].»
Le verdict demeure
incertain parce que, notamment, lors de la Grande dépression, le
taux de chômage est passé de 4% (en 1929) à près
de 25% en 1932. «Ce sont des chiffres qu’on ne voit pas encore
aujourd’hui», indique M. Grenier. Même si le
chômage croît avec plus de 500,000
nouveaux sans-emplois chaque mois aux États-Unis, les économistes
prévoient qu’il pourrait atteindre les 10 à 12% d’ici un
an ou deux. «Donc, on devrait être encore en deçà
de la situation qu’on a connue entre 1929 et 1933», estime l’analyste.
Selon lui, la crise
actuelle serait due à l’abaissement des mesures de contrôle
instaurées justement à la suite du krach
de 1929 afin d’éviter que les marchés puissent faire n’importe
quoi. Or, ces mesures ont été démantelées
progressivement à partir des années 1970. «Ces
garde-fous - et je pense notamment à la cloison établie entre
les grandes banques d’affaires et les banques commerciales - sont tombés
en 1999 (sous l’administration Clinton)», dit-il.
Selon l'universitaire,
l’«inventivité» des marchés financiers, qui ont
créé toute sorte de produits pour étendre le crédit
(dont les fameux subprimes hypothécaires), «a fait
qu’il n’y avait plus vraiment de contrôles… avec le résultat
qu’on connaît maintenant.»
D'après: Première
chaîne de Radio-Canada, Pourquoi
pas dimanche, 1er mars 2009 (vers 9h45).
.
Deux
chiffres à méditer…
Dans sa chronique de samedi, Nicholas Kristof rapporte deux données
qui en disent long.
Chaque Américain paie en moyenne 6,800
$us en assurance santé (privée) par année. C’est
dire plus de 32,000
$can pour un couple ayant deux enfants. Or, lorsqu’on dit que les
Américains ont la chance de payer beaucoup moins d’impôts
que nous, il faudrait néanmoins ajouter ce 8,000
$can de plus par personne. C’est d’ailleurs pourquoi 40 millions
d’entre eux n’a pas les moyens de se payer une telle assurance.
Par ailleurs, le chroniqueur du New York Times relève qu’en
1980, le 1% des Américains les plus riches gagnait 8% de tous les
revenus. En 2006, ce 1% s’accaparait de 23%.
Source:
Nicholas Kristof, «Franklin
Delano Obama», 28 février 2009.
.
|
Je ne suis pas venu ici pour
faire ce qu’on fait d’habitude, ni pour faire de petits pas en avant.
Je suis ici pour apporter d’importants changements, comme l’a demandé
la nation en se rendant aux urnes en novembre dernier. C’est le changement
que mon budget entreprend et c’est le changement pour lequel je me battrai
au cours des prochaines semaines. |
|
- Barack Obama, 28 février 2009 |
.
Quel cercle… vraiment
vicieux !
Les États-Unis
font face à une nouvelle «menace terroriste».
Qui plus est, celle-ci se trouve juste au sud de leur frontière.
En effet, le Mexique
est à feu et à sang depuis que les forces de l‘ordre livrent
une lutte acharnée aux cartels de la drogue. En 2008, cette
guerre a coûté la vie à plus de 6,000
personnes, dont à des centaines d’officiers de police. Les
trafiquants s’attaquent même aux hauts dirigeants de la lutte antidrogue.
Et voilà que celle-ci commence à se répandre dans
les États du sud américain.
En vérité,
les forces de l’ordre mexicaines sont confrontées à des trafiquants
suréquipés d’armes ultra-puissantes achetées en quantité
de l’autre côté de la frontière!
Comme le rapporte
le New York Times, les Mexicains sont victimes d’une véritable
hypocrisie de la part des Américains. «Le Département
de la justice vient de déclarer les cartels de la drogue mexicains
“menaces à la sécurité nationale” alors même
que nos marchands d’armes installés le long de la frontière
approvisionnent ces bandes de meurtriers.»
Les Mexicains sont
en fait victimes à la fois de l’appétit vorace des Américains
pour la drogue (le marché le plus lucratif au monde) et de leur
lobby des armes (le plus puissant du monde). Ils estiment d’ailleurs
que ces marchands ont fourni l’essentiel de 20,000
armes saisies l’an dernier sur leur territoire.
«Un vaste
marché des armes s’est installé dans les quatre États
américains longeant la frontière mexicaine, résultat
de notre laxisme dans le contrôle des armes, rapporte le New York
Times. Des hommes de paille [américains] se procurent
des fusils d’assaut auprès de l’un ou l’autre des 6,000
marchands frontaliers pour ensuite les remettre aux trafiquants.»
Les supposées
lois restreignant la vente d'armes sont si poreuses que n’importe quel
«amateur de fusils» peut se procurer tout ce qu’il veut dans
de prétendus gun shows de fin de semaine. L’un des
rares marchands à avoir été piégés par
la police américaine est ainsi accusé d’avoir vendu des centaines
de fusils mitraillettes AK-47 qui se sont ensuite retrouvés au Mexique.
«Nous devions
avoir honte, de ce côté-ci de la frontière, que notre
dépendance à la drogue soit alimentée par notre timidité
à contrôler les armes à feu», de déplorer
le quotidien new-yorkais.
Sources: Editorial, «The
Drug Cartels’ Right to Bear Arms», 27 février 2009 ; James
McKinley Jr., «U.S.
Is Arms Bazaar for Mexican Cartels», The New York Times,
25 février 2009 ; Marc Lacey, «With
Force, Mexican Drug Cartels Get Their Way». The New York Times,
28 février 2009 ; Randal Archibold, «Mexican
Drug Cartel Violence Spills Over, Alarming U.S.», The New
York Times, 22 mars 2009.
.
Comment va la bourse
?
Comment se comportent
les marchés boursiers depuis l’arrivée du nouveau président
américain?
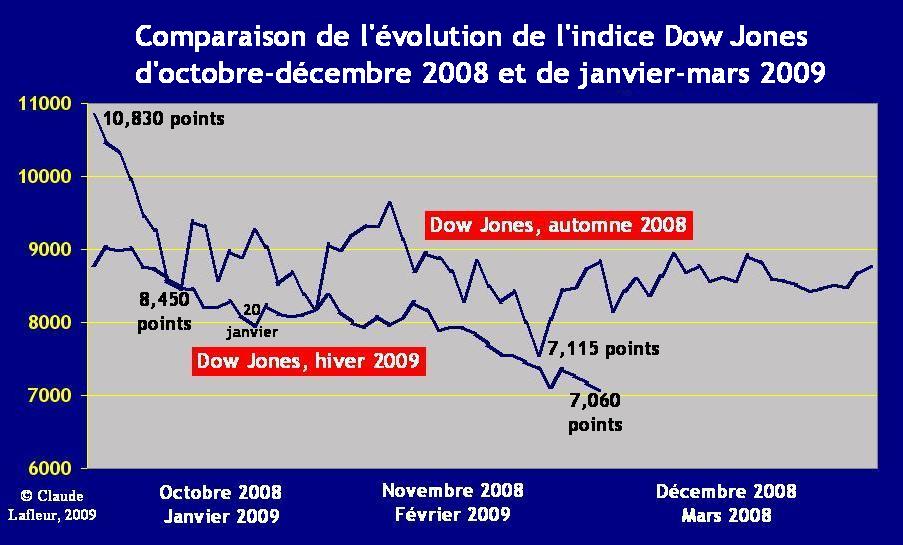 Comme l’illustre ce
graphique, les cours de la bourse – ici l’indice Dow Jones – ne cessent
de chuter depuis octobre 2008.
Comme l’illustre ce
graphique, les cours de la bourse – ici l’indice Dow Jones – ne cessent
de chuter depuis octobre 2008.
Tel que le montre
la courbe du haut, l’indice a chuté de 2200 points en dix jours
en octobre dernier, pour baisser d’un autre 1000 points le mois suivant,
avant de remonter quelque peu en fin d’année. Comme l’illustre
la courbe du bas, depuis le début de l’année 2009, le Dow
Jones a perdu un autre 1700 points, selon une descente qui ne semble pas
vouloir prendre fin.
Curieusement, cette
tendance s'est même intensifiée depuis l’entrée en
fonction du nouveau président le 20 janvier. Il semble que
quoi que dise et tente de faire Barack Obama, rien ne rassure les marchés.
.
Rêves américains
«Mardi soir,
le président Obama a dénoncé notre culture nationale
de l’irresponsabilité, commente David Brooks. Il a parlé
de la façon dont les Américains ont sacrifié le long
terme au profit du court terme, dépensé plus qu’ils pouvaient
se le permettre et comment les dirigeants du pays n’ont pas tenu leurs
promesses en reportant toute réforme. Obama a décrit une
pourriture incrustée et omniprésente.»
«Il a cependant
perpétué le mythe voulant que le peuple américain
puisse tout avoir sans faire de sacrifice, poursuit le chroniqueur du New
York Times. On veut bénéficier de soins de santé,
d’une meilleure éducation et même vaincre le cancer, alors
que 98% d’entre nous n’aura rien à payer. Le fardeau de ces
progrès incombera aux riches alors que tous les autres profiteront
de baisses d’impôt pour magaziner.»
«Le plus gros
problème réside au chapitre des soins de santé.
C’est un domaine où tout le monde désire profiter de ce qu’il
ne payera pas, où un ensemble de primes retors a créé
un coûteux système qui ne produit guère de résultats,
un système impossible à réformer…»
Source: David Brooks, «The
Uncertain Trumpet», The New York Times, 27 février
2009.
.
Quand frapperont-ils
le mur de l’endettement ?
Dans les années
1980, on s’est inquiété lorsque le gouvernement américain,
dirigé par le républicain Ronald Reagan, a multiplié
par quatre la dette nationale. (Pour ce faire, Reagan a réduit
les impôts des mieux nantis tout en augmentant substantiellement
les dépenses militaires.) La dette nationale est ainsi passée
de 827 milliards $ (sous Jimmy Carter) à 3,2 billions $ huit ans
plus tard, comme l'illustre le graphique suivant.
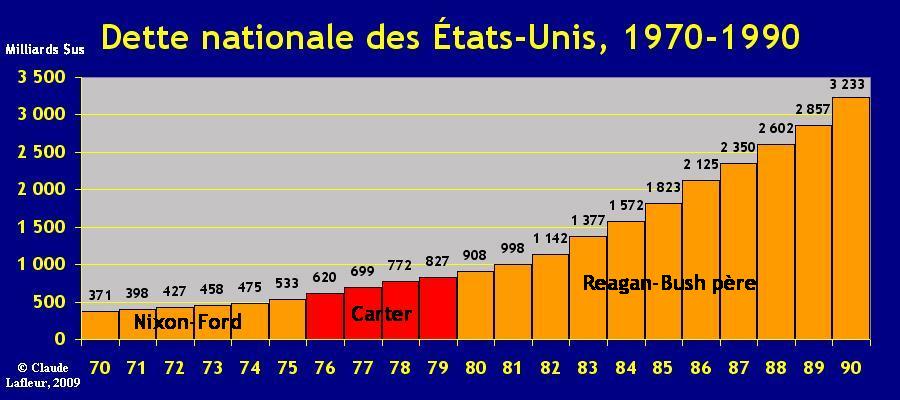 Pour la première
fois, en 1982, la dette américaine franchissait le cap du mille
milliards $ - un billion $ -, une somme inimaginable pour l’époque.
Or, dix ans plus tard, au terme de l’administration républicaine
de George Bush père, elle atteignait les 4 billions $.
Pour la première
fois, en 1982, la dette américaine franchissait le cap du mille
milliards $ - un billion $ -, une somme inimaginable pour l’époque.
Or, dix ans plus tard, au terme de l’administration républicaine
de George Bush père, elle atteignait les 4 billions $.
Heureusement que
durant les années Clinton, la croissance de la dette s’est estompée,
celle-ci n’augmentant «que de» 1,5 billion $. Mais voici
qu’après huit années d’administration républicaine
de George Bush fils, la dette a plus que doublé (passant de 5,6
à 12,7 billons). (Comme Reagan, Bush a réduit les impôts
des plus riches et augmenté prodigieusement les dépenses
miliaires.) Voir le graphique suivant.
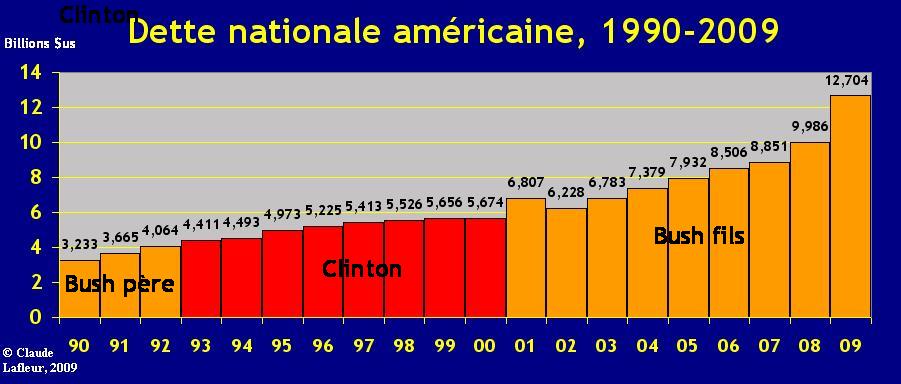 Voilà qu’à
l’occasion de son premier énoncé budgétaire, le président
démocrate Obama nous annonce que, si tout va bien, la dette
nationale doublera encore une fois d’ici dix ans - frôlant les 24
bilions - comme l'illustre le graphique suivant.
Voilà qu’à
l’occasion de son premier énoncé budgétaire, le président
démocrate Obama nous annonce que, si tout va bien, la dette
nationale doublera encore une fois d’ici dix ans - frôlant les 24
bilions - comme l'illustre le graphique suivant.
 Chaque fois que la dette
nationale franchit un cap, on nous dit que la situation est exceptionnelle
et qu’il faudra y remédier le plus tôt possible. Chaque
fois aussi, le président en exercice prédit qu’un jour prochain,
il mettra de l‘ordre dans les finances publiques.
Chaque fois que la dette
nationale franchit un cap, on nous dit que la situation est exceptionnelle
et qu’il faudra y remédier le plus tôt possible. Chaque
fois aussi, le président en exercice prédit qu’un jour prochain,
il mettra de l‘ordre dans les finances publiques.
Mais un jour, les
États-Unis frapperont un mur d’endettement, puisque même la
nation la plus puissante finira par crouler sous ses dettes. Et pourtant,
la dette ne fait qu’augmenter, comme le montre le graphique suivant.
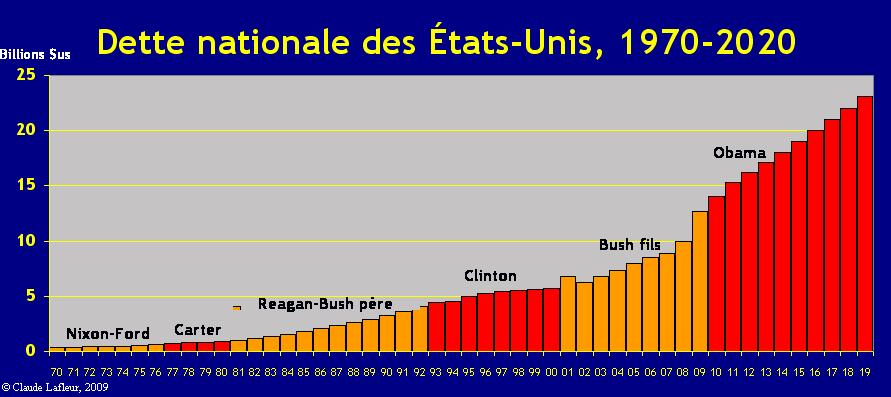 C’est ainsi qu’en cinquante
années – de 1970 à 2019 -, elle devrait passer de 371 à
23,173 milliards $! (Si on en juge par
ce qui se passe toujours, ça devrait même être pire.)
C’est ainsi qu’en cinquante
années – de 1970 à 2019 -, elle devrait passer de 371 à
23,173 milliards $! (Si on en juge par
ce qui se passe toujours, ça devrait même être pire.)
Est-ce à
dire que le mur d’endettement n’existe pas? Aucunement. Au
contraire, le choc que subiront les États-Unis le jour où
ils frapperont ce «mur» sera d’autant plus foudroyant que leur
dette sera élevée.
Quand frapperont-ils
ce «mur»? Personne ne peut le dire, le choc surviendra
inopinément, comme lorsqu'éclate une bulle spéculative:
on voit venir l'éclatement mais nul ne peut dire quand il surviendra…
Voir aussi: Editorial, «President
Obama’s Budget: Some Honesty About Taxes — Finally», The New
York Times, 27 February 2009 & David Stout, «Much
Bigger Deficits Seen in Budget Office Forecast», The New York
Times, 20 mars 2009
.
1 752 000 000 000 $
de déficit pour l’année
2009 !
Un billion, 752 milliards
$. Voilà le déficit qu’accumuleront les États-Unis
au cours de la présente année financière (d’octobre
2008 à septembre 2009). C’est plus de 55,000
$ de dettes qui s’accumulent chaque seconde! Une pile de 1,75
billion de billets de 1$ américain correspond à la distance
Terre-Lune.
C’est de loin le
plus gros déficit budgétaire jamais engagé par le
gouvernement américain (le précédent record ne correspondant
qu’au quart de cette somme: 459 milliards $), voir graphique ci-dessous.
Une telle somme augmente de 25% la dette nationale des États-Unis,
qui passerait de 10 à 12,7 billons $.
Ce déficit
- le lègue des politiques républicaines de George Bush -
résulte selon le New York Times d’une baisse de 1 billion
$ en revenus pour le gouvernement (résultat de la crise économique),
auquel s’ajoutent les coûts des programmes pour venir en aide aux
banques et la première tranche du plan Obama pour relancer l’économie,
ainsi que des frais additionnels pour les guerres menées en Irak
et en Afghanistan.
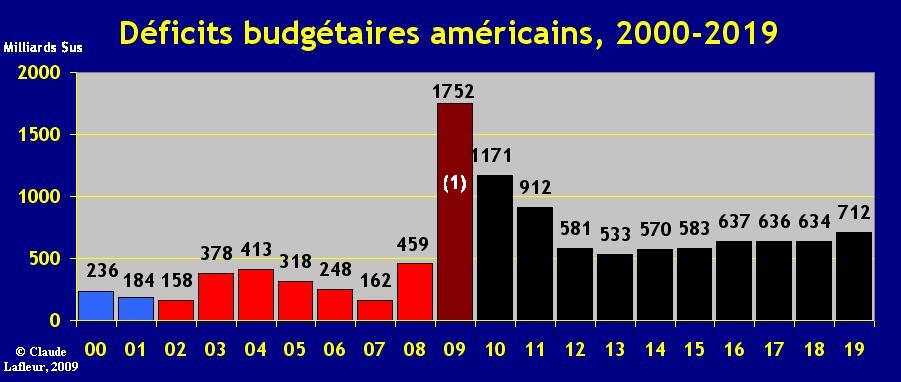
Au cours des dix prochaines
années, l’administration Obama prévoit que les déficits
du gouvernement américain totaliseront 7 billions $, alors que George
Bush en a cumulé pour 3,9 billions $ ces huit dernières années.
Les billions de dollars de déficits que se propose de faire Obama
(en noir) font ainsi pâlir ceux de l’administration Bush (en rouge).
Dire qu’au début des années 2000, l’administration Clinton
produisait des surplus budgétaires (en bleu).
Devant des déficits
aussi considérables, le président Obama nous dit que d’ici
la fin de son premier mandat (dans quatre ans), ceux-ci auront diminué
des deux tiers. Or, selon les chiffres qu’il fournit, les déficits
annuels dépasseront tout de même les 600 milliards $ par année
à la fin des années 2010. Au cours des dernières
années, on était horrifié par les déficits
records générés par George Bush… qui ne dépassaient
pourtant que les 400 milliards $ par année.
| (1) |
Pour l’année financière 2009 (qui s’est
amorcée le 1er octobre 2008), l’administration Bush prévoyait
un déficit de 407 milliards $, auquel l’administration Obama a «ajouté»
1,3 billion $ pour prendre en compte des dépenses et pertes de revenus
qu’impose la crise économique qui sévit depuis l’automne. |
Sources: Jackie Calmes &
Robert Pear, «$1.75
Trillion Deficit Seen as Obama Unveils Budget Plan», The New
York Times, 26 février 2009.
Voir aussi: «Huit
années d’administration républicaine», Le Carnet
2008, 5 février 2008.
Ressources: U.S. Government:
The
Budget Documents, Fiscal Year 2010 & Summary
Tables.
Editorials: «President
Obama’s Budget: Some Honesty About Taxes — Finally» & «President
Obama’s Budget: Progress on Health Care», The New York Times,
26 février 2009.
Analysists: David Leonhardt,
«A
Bold Plan Sweeps Away Reagan Ideas» ; John Harwood, «Budget
Choices Test Obama’s Political Skills» The New York Times,
26 février 2009 ; Paul Krugman, «Climate
of Change», The New York Times, 27 février 2009
; David Brooks, «A
Moderate Manifesto». The New York Times, 2 mars 2009 ; David
Brooks, «When
Obamatons Respond», The New York Times, 5 March 2009.
.
Pertes relatives
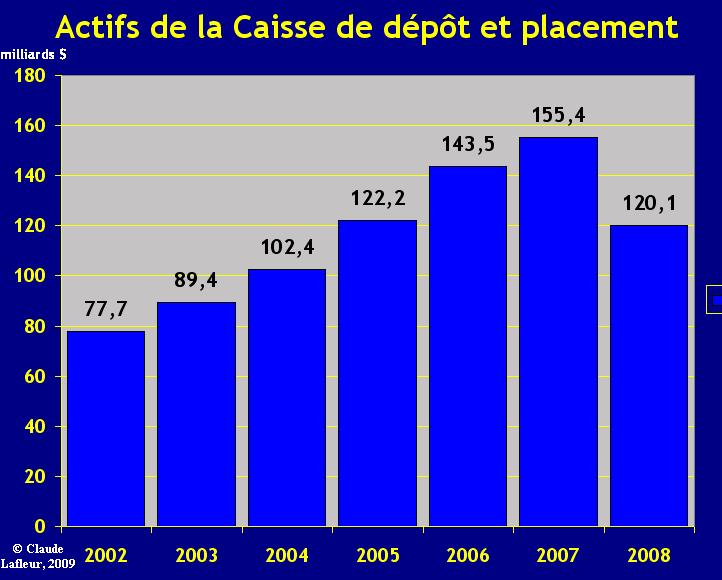 La Caisse de dépôt et placement du Québec – le «bas
de laine des Québécois assurant notre retraite» - confirme
ce qu’on soupçonnait depuis des mois: des pertes records de 39,8
milliards $. Les actifs de la Caisse sont ainsi passés de
155 milliards $ (fin 2007) à 120 milliards (fin 2008), effaçant
du coup les gains réalisés au cours des deux années
précédentes (graphique).
La Caisse de dépôt et placement du Québec – le «bas
de laine des Québécois assurant notre retraite» - confirme
ce qu’on soupçonnait depuis des mois: des pertes records de 39,8
milliards $. Les actifs de la Caisse sont ainsi passés de
155 milliards $ (fin 2007) à 120 milliards (fin 2008), effaçant
du coup les gains réalisés au cours des deux années
précédentes (graphique).
Notons au passage
que plus de la moitié de ces pertes est due à une dévaluation
de biens qui ont simplement perdu de la valeur sur papier à cause
de la crise économique. On peut en conséquence espérer
que lorsque l’économie se rétablira, une bonne part de ces
actifs retrouveront leurs valeurs. Quant aux fameux «papiers
commerciaux», ils ont entraîné de «véritables»
pertes de 6,1 milliards $.
Par ailleurs, le
mêm jour, le constructeur automobile General Motor annonce des pertes
financières de 30,9 milliards de dollars américains pour
l'année 2008 (soit exactement le même montant que la Caisse
en dollars canadiens). Ces pertes font suite aux 43,3 milliards $
perdus au cours de 2007. (Par comparaison, la Caisse avait enregistré
des gains de 12 milliards $ cette année-là.)
Les pertes de G.M.
menacent de faire disparaître l’une des plus grandes entreprises
américaines et, par le fait même, des centaines de milliers
d’emplois, tandis que les «pertes sur papier» de la Caisse
ne menacent en rien notre sécurité financière.
Pour expliquer son
rendement de –25%, la Caisse souligne que, comme pour tous les autres investisseurs,
celui-ci est avant tout du à l’effondrement de l’économie
mondiale. «En quelques jours, en octobre 2008, le monde a basculé
dans une crise financière et économique comme il ne s’en
est pas vu depuis 80 ans, rappelle-t-on. Les marchés se sont disloqués.
Toutes les catégories de l’actif – à l’exception des meilleurs
titres gouvernementaux – se sont dépréciées simultanément
et fortement. L’absence de prêteurs et d’acheteurs a fait plonger
les valeurs marchandes. La crise mondiale a aussi provoqué une forte
baisse du dollar canadien de 20% par rapport au dollar américain,
de 16% par rapport à l’euro et de 35% par rapport au yen pour l’année.
Ces événements hors du commun ont touché tous les
investisseurs.» Par comparaison, les rendements des autres
grandes caisses de retraite ont été en moyenne de -18%.
Sources: Caisse de dépôt
et placement du Québec, «La
Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un rendement
moyen pondéré des fonds des déposants de -25,0 % pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2008»
& «États
financiers cumulés 2008», 25 février 2009, Generla
Motor, «GM
Reports Preliminary Fourth Quarter and Calendar Year 2008 Financial Results»
& «G.M.
Posts $9.6 Billion Loss, Expects ‘Going Concern’ Notice», The
New York Times, 26 février 2009.
.

|
Le président
Obama à l’occasion de son premier «discours sur l’état
de l’Union» devant le Congrès américain. Derrière
lui, le vice-président Joe Biden et la speaker de la Chambre
des représentants Nancy Pelosi (respectivement premier et second
successeurs à la présidence, si jamais Obama venait à
périr).
|
|
Les États-Unis rebondiront,
prédit
le Grand orateur Obama
1 - L'heure des comptes
À l’occasion
de l’un des très grands discours politiques livré par l’un
des meilleurs orateurs, le président Obama a présenté
un bilan de l’état actuel dans lequel se trouvent les Américains
tout en énonçant des objectifs ambitieux vers lesquels il
espère rediriger la puissance innovatrice de son pays. Sur
le thème «Nous allons rebondir et retomber sur nos pieds,
les États-Unis d’Amérique ressortiront donc plus forts que
jamais!», Obama a d’abord dressé les constats suivants.
|
Le fait
est que notre économie ne s’est pas détériorée
du jour au lendemain. Non plus que tous nos problèmes sont
apparus à la suite de l’effondrement du marché immobilier
ou de la bourse.
Nous savions depuis
des décennies que notre survie dépend de la recherche de
nouvelles sources d’énergie. Pourtant, nous importons davantage
de pétrole aujourd’hui que jamais auparavant.
Le coût des
soins de santé gruge de plus en plus nos épargnes.
Pourtant, nous remettons sans cesse à plus tard les réformes
nécessaires.
Nos enfants devront
compétitionner pour du travail dans une économie mondialisée
et vis-à-vis de laquelle trop peu de nos écoles les préparent
adéquatement.
Et malgré
le fait que nous n’avons relevé aucun de ces défis, nous
nous sommes mis à dépenser et à nous endetter comme
jamais auparavant, autant en tant qu’individu que par le biais de notre
gouvernement.
En d’autres mots,
nous avons vécu dans un monde où trop souvent les gains à
court terme passaient avant la prospérité à long terme
et où on omettait de voir par-delà du prochain paiement,
du prochain semestre ou de la prochaine élection.
Le surplus [budgétaire
légué par l’administration Clinton] a servi d’excuse pour
transférer de la richesse aux plus nantis, au lieu d’être
l'occasion d'investir dans notre avenir.
Nos règlements
ont été affaiblis au bénéfice de profits rapides
et au détriment de la santé des marchés. Certains
se sont achetés des maisons sachant fort bien qu’ils n’en avaient
pas les moyens, encouragés par des banquiers et des prêteurs
avides de faire des prêts mêmes mauvais. En même
temps, des débats sérieux et des décisions difficiles
ont été sans cesse remis à plus tard.
Eh bien, le temps
de comptes est arrivé, le temps de nous occuper de l’avenir est
arrivé.
Voici le moment
d’agir énergiquement et intelligemment, non seulement pour relancer
l'économie, mais pour jeter les bases d’une nouvelle ère
de prospérité durable.
Voici le moment
de stimuler la création d’emplois, de restaurer le crédit
et d’investir dans les domaines de l’énergie, des soins de santé
et de l’éducation qui feront croître à nouveau notre
économie, tout en procédant à des choix difficiles
afin de réduire notre déficit. C’est sur ces bases qu’a été
conçu mon programme économique.» |
2 - Les trois Travaux d'Hercules
de Barack Obama
Dans son allocution,
le président Obama a précisé ce qu’il entendait faire
en matière d’énergie, de santé et d’éducation.
Il a même lancé trois défis sur un ton qui évoque
celui de John F. Kennedy conviant les Américains a déposer
un homme sur la Lune avant la fin de la décennie 1960.
|
1° - À la conquête
des énergies propres
Nous savons que la pays
qui disposera de la puissance d’une énergie propre et renouvelable
dominera le 21e siècle. Pourtant, c’est la Chine qui s’est
lancée dans le plus vaste projet de l’histoire pour rendre son économie
énergétiquement efficace. Nous avons inventé la technologie
solaire, mais nous figurons derrière des pays comme l’Allemagne
et le Japon en terme de production. Des autos hybrides sortent de
nos usines mais elles fonctionnent avec des piles fabriquées en
Corée.
Eh bien, je n’accepte
pas un avenir où les emplois et les entreprises se retrouveront
à l’étranger, et je sais que vous ne l’acceptez pas non plus!
Le moment est venu pour les États-Unis de redevenir le chef de file.
Grâce à
notre plan de relance économique, nous doublerons, au cours des
trois prochaines années, nos approvisionnements en énergie
américaine. Nous prenons aussi l’engagement de faire le plus
important investissement de l’histoire des États-Unis pour financer
la recherche de base, un investissement qui produira non seulement de nouvelles
découvertes en énergie, mais également des percées
en médecine, en science et en technologie.
Nous allons bientôt
déployer des milliers de kilomètres de lignes électriques
qui pourront acheminer l’énergie produite par de nouvelles sources
vers les villes et les communautés de tout le pays. Et nous mettrons
les États-Unis à l’oeuvre pour construire des maisons et
des édifices plus efficaces afin d'économiser des milliards
$ en facture énergétique.
Mais pour vraiment
transformer notre économie, pour mieux assurer notre sécurité
et pour préserver la planète contre les ravages des changements
climatiques, nous devrons en fin de compte recourir à des formes
d’énergie plus propres, renouvelables et réellement rentables.
Je demande donc
au Congrès de me soumettre un projet de loi qui instaurera une taxe
sur la pollution générée par le carbone et qui stimulera
la production d’énergie renouvelable aux États-Unis.
Aussi, pour appuyer
ces changements, nous investirons 15 milliards $ par année dans
le développement de technologies telles que les éoliennes
et les centrales solaires, les biocarburants améliorés, le
charbon propre et les autos et camions plus efficaces construits ici aux
États-Unis.
Parlant de l’industrie
de l’automobile, chacun de nous savons que des années de mauvaise
gestion et la récession actuelle précipitent les fabricants
d’autos au bord du gouffre. Nous ne devons pas les protéger
contre leurs mauvaises façons de faire et nous ne le ferons pas.
Mais nous devons
cependant nous engager à concevoir et à rééquiper
une industrie nouvelle capable de compétitionner et de triompher.
Des millions d’emplois en dépendent, tout comme une multitude de
communautés. Et je crois que la nation qui a inventé
l’automobile ne peut la laisser aller.
Maintenant, rien
de tout cela ne se fera sans coûts, ni ne sera facile. Mais
nous sommes les États-Unis, nous ne faisons pas ce qui est facile,
nous faisons ce qui est nécessaire pour faire progresser notre pays.
2° - L'obligation de réformer
la santé
Pour la même raison,
nous devons aussi nous préoccuper des coûts oppressants des
soins de santé.
Ces coûts
provoquent à présent chaque trente secondes une faillite
aux Etats-Unis. D’ici la fin de l’année, ils pourraient amener
1,5 million d’Américains à perdre leur maison. Au cours
des huit dernières années, les primes d’assurance santé
ont grimpé quatre fois plus rapidement que les salaires. Au
cours de chacune de ces années, 1 million d’Américains de
plus ont perdu leur assurance santé.
C’est l’une des
principales raisons pour lesquelles les petites entreprises ferment leurs
portes et pour les grandes d'expédier des emplois outremer.
Et c’est l’une des portions de notre budget qui croît le plus considérablement
et le plus rapidement. Étant donné tous cela, on ne
peut plus se permettre de reporter la réforme des soins de santé.
Le temps est venu. C'est le temps.
D'ores et déjà,
nous avons fait davantage en 30 jours pour faire progresser ce dossier
que durant la dernière décennie. Le [nouveau] Congrès
siégeait depuis à peine une journée lorsqu’il a adopté
la loi fournissant une assurance santé à 11 millions d’enfants
dont les parents travaillent à temps plein.
Notre plan de relance
investira dans les dossiers de santé électronique et dans
les nouvelles technologies qui réduiront les erreurs, diminueront
les coûts, assureront la confidentialité et préserveront
des vies.
Il lancera un nouveau
programme pour venir à bout d’une maladie qui touche pratiquement
tout le monde, y compris moi-même, en cherchant une cure contre le
cancer.
Il propose le plus
important investissement jamais fait dans les soins préventifs,
puisque c’est l’une des meilleures façons de maintenir les gens
en santé tout en contrôlant nos coûts.
Notre budget repose
sur ces réformes. Il inclut l’engagement historique d’une
réforme complète des soins de santé, un premier pas
dans la nécessité d'assurer des soins de qualité et
abordables pour tout Américain.
Cet engagement se
paiera en partie grâce à l’amélioration de l’efficacité
du système et c’est une étape que nous devons franchir si
nous voulons parvenir à réduire le déficit des années
à venir.
Je ne me fais pas
d’Illusion sur le fait qu’il s’agit d’une démarche difficile.
Mais soyons clairs: la réforme des soins de santé ne peut
plus attendre. Elle ne doit plus attendre et elle n’attendra pas
une année de plus!
[Notons qu’en 1992,
Bill Clinton, alors nouveau président des États-Unis, avait
justement confié à son épouse le mandat pressant de
réformer le système d'assurance santé. Celle-ci,
bien que déterminée et bénéficiant de l’appui
absolu du président, s’est néanmoins rapidement buttée
aux lobbies pour qui la situation actuelle représente une valeur
incalculable.]
3° - Aucun Américain ne devra
abandonner ses études
Le troisième
défi que nous devons relever, c’est la nécessité d’améliorer
l’éducation aux États-Unis.
À l'heure
où l’économie se mondialise, où la valeur la plus
précieuse que possède tout individu est son savoir, une bonne
éducation n’est plus simplement une voie qui ouvre des portes, c’est
un prérequis.
Désormais,
les trois-quarts des emplois qui augmentent le plus rapidement requièrent
au moins un diplôme secondaire. Or, à peine plus de
la moitié de nos citoyens en possède un. Nous avons
l’un des plus hauts taux de décrochage scolaire des pays industrialisés
et la moitié de nos étudiants qui commence leur secondaire
ne le terminera pas.
C’est un constat
qui nous mène vers un déclin économique, parce que
nous savons que les pays qui nous déclassent aujourd’hui en éducation
nous surclasseront demain économiquement. Voilà pourquoi
l’objectif de notre gouvernement est de s’assurer que chaque enfant aura
accès à une éducation complète et de qualité,
depuis sa naissance jusqu’à ce qu’il amorce sa carrière.
C’est l’engagement que nous devons à nos enfants!
[...]
Ce soir, je demande
donc à chaque Américain de s’engager à réaliser
au moins une année de plus d’études supérieures ou
en formation professionnelle. Qu’importe de quel type de formation
il s’agira, chaque Américain devra posséder davantage qu’un
diplôme de secondaire.
Abandonner l’école
ne sera plus un choix, puisque cela n’équivaut pas qu’à un
abandon personnel mais c’est aussi abandonner votre pays. Et votre
pays a besoin du talent de chacun de ses citoyens et il l’apprécie.
Voilà pourquoi
nous fournirons les appuis nécessaires afin que chaque jeune Américain
complète sa formation scolire afin de parvenir à notre objectif:
faire en sorte que d’ici 2020, les Etats-Unis disposent de la proportion
la plus élevée de diplômés au monde. C’est
un objectif que nous devons atteindre! |
Source: Transcript of President
Obama’s Address to Congress, The New York Times, 24 février
2009.
À lire aussi: Editorial,
«Time
of Reckoning», The New York Times, 24 février 2009.
.
Une «fabuleuse
expérience» politique
David Brooks,
chroniqueur au New York Times, commente: «Le président
Obama s’est entouré d’une équipe qui déploie une série
de mesures visant à: créer trois millions d’emplois, réformer
le système de santé, sauver l’industrie de l’auto, revigorer
l’immobilier, réinventer le secteur énergétique, revitaliser
les banques, réformer nos écoles – tout en réduisant
de moitié le déficit budgétaire.»
«Si jamais
une telle révolution était possible, poursuit-il, c’est le
bon moment et la bonne équipe pour y parvenir. La crise exige
une riposte vigoureuse. Ceux qui entourent Obama sont intelligents
et réfléchis. Leurs plans sont audacieux mais empreints
de souplesse et de sensibilité à la réalité.»
«Pourtant,
je crains qu’en tentant de tout faire en même temps, ils ne fassent
rien de bon. J’ai peur d’être en présence d'une équipe
qui ne maîtrise pas encore son nouveau réseau téléphonique
mais qui tente néanmoins de rénover la moitié de l’économie
américaine. J’ai peur qu’elle se soit lancée dans le
plus grand défi administratif de l‘histoire américaine en
se privant de ceux qui pourraient lui être les plus utiles: les vétérans
de la fonction publique maintenant inscrits comme lobbyistes.» [Rappelons
qu’Obama a interdit à tout «lobbyiste» de réintégrer
son administration.]
«Chaque fois
que l’administration Obama rend public l’une de ses mesures, je lis vingt
économistes différents et j’obtiens vingt avis différents.
À n’en point douter, nous assistons à la plus fabuleuse expérience
politique de notre vie.»
Source: David Brooks, «The
Big Test», The New York Times, 23 février 2009.
.
Gérer un avenir… vraiment pas rose
Dans un article qu’il faut lire,
Frank Rich démontre à quel point il nous est difficile de
faire face à la réalité, particulièrement aux
mauvaises nouvelles qui s’accumulent. Il souligne en outre avec justesse:
«Au vingt-neuvième jour de sa
présidence, Barack Obama a signé la loi visant à stimuler
l’économie. Mais la Terre n’a pas tremblé pour autant.
Le Dow Jones a chuté de près de 300 points. GM et Chrysler
ont réclamé 21,6 milliards $ de plus en fonds publics, tout
en annonçant 50,000 nouvelles mises
à pied. Le plus récent financier-voleur, Allen Stanford,
a été accusé d’avoir commis une fraude de 8 milliards
$ au dépens de 50,000 épargnants.»
«Je ne prétends pas qu’aujourd’hui
marque la fin de nos problèmes économiques, a déclaré
mardi le président lors de la cérémonie de signature,
mais j’espère que ce jour marque le début de la fin.»
«Pauvre président, d’enchaîner
le chroniqueur du New York Times. Alors qu’il déploie
ses mesures de sauvetage les unes après les autres, il ne peut savoir
lesquelles donneront des résultats. Et s’il nous dit toute
la vérité sur ce qui nous attend, il risque d’aggraver la
peur qu’éprouvent déjà les Américains paniqués.
(Selon le plus récent sondage publié par Associated Press,
la moitié des Américains craignent de perdre leur emploi.)
Mais si par contre il adoucit trop la réalité, le pays pourrait
lui tenir rigueur des calamités qui s’abattront éventuellement,
comme lorsque l’administration Bush répétait ses prétentions
de «succès» en Irak et qui n’était que mensonges.
Gérer ce que nous réserve l’avenir exigera d’Obama chaque
parcelle de son intelligence, de son doigté et de son talent oratoire.»
Source: Franck Rich, «What
We Don’t Know Will Hurt Us», The New York Times, 21 février
2009.
.
Finançons l’avenir,
non le passé
Au lieu de soutenir
financièrement GM et Chrysler, qui ne cessent de réclamer
des milliards à nos gouvernements, consacrons plutôt ces fonds
publics aux entrepreneurs, aux créateurs et aux innovateurs qui
tentent de développer les technologies de l‘avenir, préconise
Thomas Friedman, chroniqueur au New York Times.
«J’ai l’impression
que nous subventionnons les perdants pour une seule raison: parce qu’ils
prétendent que leurs funérailles coûteraient plus cher
que de les maintenir sur respirateur artificiel. Désolez les
amis, mais ce n‘est pas la façon de faire américaine.
Porter secours aux perdants n’est pas la méthode selon laquelle
nous sommes devenus un pays riche, et ce n’est pas de cette façon
que nous nous en sortirons cette fois-ci.»
«Lorsqu’il
est question d’aider des entreprises, les précieux fonds publics
devraient servir aux nouvelles entreprises, et non à celles au bord
de la faillite», poursuit-il.
«Vous êtes
disposés à dépenser 20 milliards $ pour créer
des emplois? Excellent. Contactez plutôt les vingt plus
importantes firmes de capital de risques américaines, qui manquent
de fonds parce que leurs partenaires - les dotations universitaires et
les fonds de pension – sont à sec, et faites-leur la proposition
suivante. Le Trésor américain fournira à chacune
d’elles 1 milliard $ pour qu’elles financent les meilleurs projets à
capitaux de risque qu’elles ont dans leurs cartons. Lorsque l’un
de ces projets échoue, tout le monde y perd. Mais si l’un
d’eux devenait le prochain Microsoft ou Intel, les contribuables vous octroieront
20% de la valeur de l’investissement et en conserveront 80%.»
«Quant à
dépenser des milliards de l’argent des contribuables, cela ne peut
être que sur la décoration des bureaux de banquiers, sur des
spéculateurs immobiliers ou des dirigeants automobiles qui consacrent
leur énergie, année après année, à résister
aux changements et a faire pression auprès de Washington, au lieu
d’innover et de supplanter Toyota.»
«Notre pays
regorge toujours d’innovateurs qui recherchent des capitaux. Assurons-nous
que les perdants qui réclament de l’aide n’entraîneront pas
avec eux d’éventuels gagnants qui pourraient nous amener à
sortir de la crise. Certaines de nos meilleures entreprisses, dont
Intel, sont nées en temps de récession, lorsque la nécessité
rend l’innovation encore plus nécessaire et les preneurs de risque
encore plus courageux.»
«Nous sommes
à terre, mais pas vaincus. En investissant l’argent des contribuables,
concentrons-nous sur la création de la nouvelle génération
de biotechs, d’infotechs, de nanotechs et de cleantechs, sur de véritables
innovateurs, de véritables emplois du 21e siècle et possiblement
de véritables profits pour les contribuables. Notre devise
devrait être: “Créations et non sauvetages. Aidons les
futurs Google, non les GM du passé.”»
D'après: Thomas Friedman,
«Start
Up the Risk-Takers», The New York Times, 21 février
2009.
.
Quand sortirons-nous
de l’«enfer» économique ?
Comment viendrons-nous
à bout de la crise économique et, surtout, combien de temps
durera-t-elle? C’est la question à laquelle s’attaque Paul
Krugman, économiste (et Nobel 2008) du New York Times.
Celui-ci cite d’abord
la vision des analystes du comité des marchés de la Federal
Reserve américaine pour qui la crise devrait durer des années.
«Tous les participants prévoient que le chômage demeurera
nettement au-dessus d’un taux viable à long terme jusqu’à
la fin de 2011, même en l’absence de tout nouveau choc économique.
Quelques-uns estiment qu’au moins cinq à six années s’écouleront
avant que l’économie ne revienne à un niveau caractérisé
par des taux de croissance et de chômage viables.»
Comme on compare
souvent la crise actuelle à la Grande dépression des années
1930, Krugman rappelle que celle-ci est survenue lorsque les bulles spéculatives
des marchés et du crédit ont éclaté, jetant
par terre une bonne part du système bancaire. «Le Fed
a bien tenté de revigorer l’économie en baissant ses taux
d’intérêt, rappelle l’économiste, mais même des
taux frôlant le zéro n’ont pas suffi à mettre fin à
la longue et intense période de chômage. Nous vivons
une crise fort semblable, les taux d’intérêt étant
déjà près de zéro alors que l’économie
continue de chuter. La Grande dépression a pris fin avec la
Seconde guerre mondiale, ce que personne n’espère voir se répéter.»
Selon l’économiste,
la crise finira par passer d’elle-même, c’est-à-dire lorsque
la consommation reprendre naturellement. Il voit déjà
les signes de ce processus dans la baisse de construction des maisons et
des automobiles. Évidemment, avec le temps – notamment grâce
à la croissance normale de la population -, davantage de maisons
seront requises, ce qui assainira naturellement le marché immobilier.
De même, les voitures s‘usant, d’ici quelques années, il faudra
rajeunir le parc automobile. Autrement dit, l’offre qui dépasse
actuellement de beaucoup la demande finira par s’inverser et l’économie
reviendra progressivement à la normale.
Il s’agirait donc,
pour nous comme pour nos gouvernements, de «patienter» tout
en soutenant tant bien que mal l’économie le temps que les marchés
s’assainissent (et qu’un certain ménage se fasse). Ce sera
long et pénible, évidemment.
Source: Paul Krugman, «Who’ll
Stop the Pain?», The New York Times, 19 février 2009.
.
Une autre façon
de combattre le terrorisme
La communauté
musulmane d’Inde refuse d’enterrer les neuf terroristes qui ont péri
lors des attentats de Mumbai le 26 novembre dernier et où 170 innocents
ont été tués (dont 33 musulmans). «C’est
une excellente nouvelle», nous dit Thomas Friedman.
Les neuf dépouilles
demeurent à la morgue d’un hôpital de la capitale indienne
parce que les autorités du cimetière musulman les considèrent
comme des assassins et non comme des martyrs. Ils refusent par conséquent
de leur donner une sépulture.
«Ceux
qui commettent des crimes haineux ne peuvent être considérés
comme des musulmans», déclare Hanif Nalkhande, porte-parole
de la fondation qui gère le cimetière. «Le terrorisme
n’a pas sa place dans la doctrine islamique, ajoute M.J. Akbar, rédacteur
en chef d’un quotidien musulman indien. Le Coran dit clairement que l’assassinat
d’innocents équivaut à s’attaquer à la communauté.
Et puisque les terroristes ne sont ni Indiens ni d’authentiques musulmans,
ils n’ont pas leur place dans un cimetière musulman indien.»
«Une dénonciation
aussi forte du terrorisme islamique mérite d’être soulignée,
commente le journaliste du New York Times. Il s’agit de dénoncer
les meurtriers, en majorité sunnite, qui s'attaquent aux civils
dans les mosquées et sur les marchés publics en Irak comme
au Pakistan ou en Afghanistan et qui sont souvent traités par les
grands médias arabes comme des martyrs dont le suicide doit être
glorifié.»
Comme le souligne
avec justesse Friedman, lorsque des assassins sont considérés
par leur communauté comme étant légitimes d’attaquer
les «ennemis» à l’étranger, cela finit par se
retourner contre elle, les meurtriers s’attaquant éventuellement
aux «ennemis de l’intérieur», comme cela se fait maintenant
en Irak, en Afghanistan et au Pakistan.
«La seule
façon d’y mettre fin est que la communauté musulmane elle-même
dise “c’est assez!“, d'écrire Friedman. Lorsqu’une culture
ou une communauté de croyants condamne ce type de comportement ouvertement,
avec force et constance, cela finit par être plus efficace que tous
les détecteurs de métaux et contrôles policiers.»
«C’est pourquoi
les musulmans indiens, qui forment la deuxième communauté
musulmane d’importance au monde (après celle d’Indonésie),
rend un grand service à l’Islam en délégitimant les
meurtriers terroristes en refusant d’enterrer leurs dépouilles.
Cela ne mettra pas fin à ce comportement du jour au lendemain, mais
c’est un pas dans la bonne direction.»
«L’Islam dit
que si vous vous suicidez, même après votre mort, vous serez
châtié», rappelle Raashid Alvi, député
musulman au Parlement indien.
D'après: Thomas Fridemand,
«No
Way, No How, Not Here», The New York Times, 18 février
2009.
.
Barack le Sage
Vendredi dernier,
Bob Herbert a été l’un des journalistes qui ont eu le privilège
de participer à un bel entretien avec le président Obama
alors que tous faisaient route vers Chicago à bord de l’avion présidentiel
Air
Force One.
Entre autres, rapporte
le chroniqueur du New York Times, le président considère
que le fait que toutes ses tentatives d’établir un dialogue non
partisan avec les républicains ont échoué ne l’empêchera
pas de persévérer. «Chaque fois que nous tenterons
de faire quelque chose, a dit le président, je solliciterai la contribution
autant des démocrates que des républicains en disant: “Voici
les raisons pour lesquelles j’entends faire ceci. Je veux avoir votre
point de vue, même divergent. Si vous avez de meilleures idées,
présentez-les moi. Nous les inclurons dans nos projets et
nous sommes même prêts à faire des compromis sur certains
enjeux d’importance pour l’un comme pour l’autre, afin de faire avancer
les choses.”»
«Lorsque je
lui ai demandé s’il y a des raisons de croire que le Parti républicain
a vraiment été de bonne foi dans le dialogue bipartisan,
étant donné que seulement trois de leurs sénateurs
ont voté en faveur de son plan économique et aucun représentant,
le président m’a dit qu’il ne voulait pas questionner les motifs
ni la sincérité de ceux qui s’opposent à son plan.»
«Il s’est
cependant empressé d’ajouter: “Mais je dois dire qu’étant
donné qu’ils ont occupé le devant de la scène durant
pas mal de temps avant mon arrivé et que leur conception a été
testée assez souvent et qu'elle nous a mené dans la situation
où nous avons accumulé une dette dépassant le billion
de dollars ainsi que dans la plus grande crise économique depuis
la Grande dépression, je pense que ma vision économique est
meilleure que la leur.”»
Questionné
à propos de la chute boursière qui a suivi l’annonce
par son secrétaire au trésor Tim Geithner du programme gouvernemental
visant à aider les banques. M. Obama a répondu: «Mes
plans ne se basent pas sur la réaction instantannée des marchés.
En fait, on peut dire qu’une bonne part de nos problèmes vient de
ce que tout le monde planifie en fonction de la réaction instantannée
des marchés, ou de leur réaction trimestrielle et qu’en conséquence,
personne ne pense plus à long terme.»
«Mon travail
consiste donc à aider le pays à voir plus loin, à
m’assurer que non seulement nous cesserons de penser à court terme
mais que nous éviterons de perpétuer le cycle des bulles
spéculatives qui éclatent encore et encore. [Je veux
aussi faire en sorte] que nous ne discuterons pas dans trente ans des problèmes
d’énergie comme nous le faisons depuis trente ans, ni non plus que
nous déplorerons l’état de nos écoles dans trente
ans comme nous le faisons depuis les années 1980.» Le
président espère aussi que les États-Unis cesseront
d’être le pays qui consacre le plus d’argent par habitant pour la
santé de ses citoyens mais qui obtient pourtant des résultats
plutôt navrants.
De cet entretien,
Barack Obama est ressorti, aux dires du journaliste, «comme
l’exemple du genre de personne qu’on espère voir occuper les plus
hautes fonctions publiques. Il est intelligent, mature, réfléchi,
calme en temps de crises et, si le pays est chanceux, ce pourrait même
être un sage.»
Source: Bob Herbert, «Obama
Riding the Wave», The New York Times, 16 février
2009.
.
La décennie des illusions
La Réserve fédérale vient
de publier une étude révélatrice sur le sort de l’Américain
moyen, rapporte Paul Krugman du New York Times. Cette étude
révèle que, pour la décennie qui s’achève,
l’avoir des foyers américains n’a à toute fin utile pas augmenté,
alors qu’ils se sont considérablement endettés. Leur
valeur nette, ajustée pour tenir compte de l’inflation, est même
inférieure
à ce qu’elle était en 2001, précise le rapport.
«Voilà qui n’étonnera
personne, commente l’économiste. Au cours de la décennie,
les États-Unis ont été une nation d’emprunteurs et
de dépensiers, non d’économes. Le taux d’épargne
personnelle est passé de 9% dans les années 1980 à
5% dans les années 1990 et à seulement 0,6% pour les années
2005-2007, alors que l’endettement a crû beaucoup plus rapidement
que les revenus personnels.»
«Pourtant, poursuit-il, jusqu’à
tout récemment, les Américains croyaient qu’ils s’enrichissaient
constamment, leurs relevés indiquant que leur maison et leurs placements
en bourse s’appréciaient plus vite que les dettes qu’ils contractaient.
Hélas, l’augmentation de la valeur de leurs biens était une
illusion, alors que leur endettement est bien réel… Tout porte
à croire qu’il faudra des années pour que l’Américain
moyen rétablisse sa situation.»
C’est ainsi que la décennie qui s’achève
pourrait passer à l’histoire comme étant celle des illusions
- des illusions au plan de l’économie, de la guerre, du terrorisme,
etc. Et qui sait, peut-être entrons-nous dans la décennie
des illusions perdues… ou des valeurs rétablies?
Source: Paul Krugman, «Decade
at Bernie’s», The New York Times, 15 février 2009
; The Federal Reserve Board, «Changes
in U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of
Consumer Finances», 12 février 2009.
.
Dégénérations
On considère
qu’une nouvelle génération d'êtres humains apparaît
tous les 25 ans environ. C’est-à-dire que 25 ans après
la naissance d’un individu, celui-ci donne naissance à ses enfants
qui, 25 ans plus tard, donneront naissance aux leurs, et ainsi de suite.
Considérant
que les premiers hommes modernes - nous, les homos sapiens -, sont
apparus il y a 150 mille d’années, on pourrait dire que six mille
de générations nous ont précédées.
Au départ,
l’évolution du genre humain s’est faite extraordinairement lentement
puisque les trois premiers milliers de générations ont vécu
dans des grottes ou dans la savane sans même maîtriser le feu
et des outils. En réalité, durant 92% de notre existence,
nous avons vécu en nomades, comme chasseurs et cueilleurs, puisque
ce n’est que depuis cinq cents générations seulement que
nous avons commencé à vivre dans des villages. C’est
fut la
première grande révolution, puisque nous avons
alors entrepris de cultiver la terre et de fonder des civilisations.
On peut considérer
que la civilisation en tant que telle - le fait de vivre dans des systèmes
sociaux organisés et complexes et de faire du commerce - remonte
à 250 générations. C'est alors qu'on a inventé
l’écriture et l’arithmétique (pour commercer), ce qui marque
la première révolution dans le domaine des communications.
On peut aussi considérer que la «pensée évoluée»
date d'une centaine de générations seulement, soit de l'époque
des grands philosophes grecs de l’Antiquité.
Quant à l’ère
moderne – qui s’amorce avec la découverte par les grands explorateurs
européens des Amériques et du reste du monde, ainsi qu’avec
les premières observations scientifiques (de Vinci et Galilée)
-, elle remonte à une vingtaine de générations seulement.
C’est aussi l’époque où Gutenberg invente l’imprimerie, la
deuxième révolution du monde des communications. Quant
à la musique classique, aux arts de la scène et à
la littérature (modernes), elles n’existent que depuis une quinzaine
de générations.
Le deuxième
grande révolution de l’humanité s’est amorcée
il y a huit générations à peine: l’ère industrielle.
Désormais, des machines équipés de moteurs remplacent
les animaux et les hommes pour les durs travaux. Ces machines multiplient
à l’infini la puissance du travail musculaire. La révolution
industrielle a mis un terme a cinq cents générations d’agriculteurs.
Nous passons alors à une civilisation technologique, le travail
des champs étant remplacé par la production industrielle
en usine. Les grandes villes rassemblant des centaines de milliers
de travailleurs apparraissent il y a environ six générations.
Avec la révolution industrielle s'impose le pétrole et autres
carburans fossils, la chimie et la pharmaceutique.
La troisième
révolution des communications s’amorce il y a moins de six générations,
avec l’avènement du téléphone, du télégraphe
et du phonographe. C’est également l’époque de la publication
des premiers journaux et magazines. La vague suivante des appareils
de communication (radio, télé et cinéma) remonte à
peine à 3 ou 4 générations.
En parallèle
s’est produite la révolution des transports, avec pour commencer
les navires propulsés par moteurs (et non plus par voile ou rames),
puis la mise au point du train, de l’automobile et finalement de l’avion.
C’est aussi l’ère de l’électrification, d’abord des rues
puis des résidences (les merveilles de l'électricité)
et de l’installation des égouts et des aqueducs (les bienfaits de
l'eau courante). Dans bien des coins du monde, ces remarquables avancées
technologiques ne remontent qu’à trois ou quatre générations.
La plus récente
vague en matière de communication surgit il y a deux générations,
avec la mise en place des satellites de communication et des services de
nouvelles télé 24 heures sur 24. Ceux-ci transforment
notre planète en un village global où tout ce qui s’y passe
est connu et vu instantanément.
Enfin, il y a une
génération sont apparus les ordinateurs personnels puis l’Internet,
deux révolutions que personne n’avait vu venir et qui bouleversent
profondément notre société. Il pourrait même
s'agir de la troisième grande révolution… mais il
est beaucoup trop tôt pour le dire.
.
Billions de dollars
Entre 1990 et 2007, le total des hypothèques
contractées par les Américains est passé de 2,5 à
10,5 billions $. Cette fulgurante augmentation est au coeur de la
bulle du crédit qui a éclaté en 2008.
Pour soutenir l’économie, l’administration
Bush a engagé des dépenses gouvernementales de 1,7 billion
$, tout en garantissant des emprunts, des investissements et des épargnes
d'une valeur de 8 billions $.
L’administration Obama envisage engager 800
milliards $ dans un premier effort pour stimuler l’économie en général,
1 billion $ dans une nouvelle tentative de sauvetage des banques, un autre
billion $ pour réformer le système de santé et enfin
un billion $ dans le financement d’un éventuel programme de sortie
de crise.
Et que représente un billion de dollars?
C’est comme si vous pouviez dépenser 1 million $ chaque heure
de votre vie, à partir de l'instant de votre naissance jusqu’à
celui de votre décès… à l’âge de 114 ans!
(Une autre façon de contempler la chose: 1 billion de secondes équivalent
à 32,000 ans. Qu'y avait-il sur
Terre il y a 1 billion de secondes? Que des hommes préhistoriques
vivant dans des grottes.)
Inspiré de David Brooks, «The
Worst-Case Scenario», The New York Times, 12 février
2009.
.
La Solution à
la crise économique : l’immigration !
La solution pour
rebâtir notre économie serait simple, rapporte Thomas Friedman,
chroniqueur au New York Times: il ne s’agirait pas tant d’y engloutir
des centaines de milliards de fonds publics que d'ouvrir nos portes à
l’immigration.
«Tout
ce que vous avez à faire, c’est d’accorder des visas à deux
millions d’Indiens, de Chinois et de Coréens, lui a lancé
Shekhar Gupta, rédacteur en chef du quotidien The Indian Express.
Nous achèterons vos maisons en faillite. Nous travaillerons
18 heures par jour pour les payer. Nous améliorerons immédiatement
votre taux d’épargne puisque pour nous, ne pas payer son hypothèque,
c'est une honte. Et nous mettrons sur pied de nouvelles entreprises
pour créer nos propres emplois et du travail pour vous, Américains.»
Friedman rapporte
que plusieurs hommes d’affaires qu’il a rencontrés en Inde lui ont
adressé le même message: «Très chers Américains,
s’il vous plaît, rappelez-vous comment vous êtes devenus le
pays le plus riche de l’histoire. Ce n’est pas en faisant du protectionnisme,
ni en nationalisant vos banques ou en redoutant le libre-échange.
Non. La formule est très simple: retablissez une économie
extrêmement souple et vraiment ouverte, acceptez la destruction créative
afin que le capital moribond puisse rapidement être recyclé
dans le financement de meilleures idées et entreprises, puisez à
même la diversité des immigrants venus de tous les coins de
la planète, profitez de leur intelligence et de leur énergie…
et répétez, répétez et répétez
à nouveau cette recette.»
Bien que nous ne
soyons pas Américains, ne pourrions-nous pas tirer profit, à
notre manière, de cette recette?
Source: Thomas Friedman, «The
Open-Door Bailout», The New York Times, 11 février
2009.
.
Premiers faux pas pour
Obama
L’administration
Obama, en poste depuis à peine trois semaines, connaît déjà
ses premières ratées. Le nouveau président espérait
signer dès son arrivée en fonction un programme de relance
de l’économie de 800 milliards $. Dans un effort visant à
mettre fin à la partisanerie qui a caractérisé l’administration
Bush, il a tenté d’y associer les républicains. Peine
perdue, puisque trois semaines plus tard, son plan demeure embourbé
au Congrès, victime de la partisanerie qui sévit depuis des
décennies.
Ce matin, son secrétaire au Trésor, Tim Geithner, a présenté
un programme visant à rétablir la confiance des marchés.
Or, tous les observateurs ont été éberlués
de découvrir à quel point les mesures annoncées restent
vagues. En particulier, on n’a aucune idée comment fonctionnera
le fonds d'investissement public-privé chargé de délester
les banques des actifs toxiques qui les empêchent de prêter.
Résultat: les marchés boursiers se sont effondrés.
Il y a une semaine,
deux personnalités auxquelles le président désirait
confier des postes clés – dont Tom Daschle, pressenti comme secrétaire
à la Santé - ont dû renoncer à leurs fonctions
en raison de leurs démêlés avec le fisc. (Tout
à son honneur, le président n’a pas hésité
à avouer: «J'ai foiré! J'en prends la responsabilité
et nous allons faire en sorte que cela ne se reproduise plus.»)
Hélas, de
plus en plus, Barack Obama s’assimile à un homme de compromis incapable
de faire avancer les choses. Dès septembre
dernier, il était apparu comme «un homme porté
sur l’analyse, la consultation et le travail en équipe… mais qui
paraîtra ainsi un leader indécis.»
En tenant à
tout prix à associer les républicains à la remise
en état de l‘économie, Barack Obama ne réalise peut-être
pas que ceux-ci n’ont aucun intérêt à ce qu’il réussisse.*
En effet, s’il parenait à remettre l'économie sur pied, sa
réélection en 2012 serait pratiquement assurée.
Par contre, s’il échoue – surtout si les républicains semblent
n’être pour rien dans cet échec -, ceux-ci auront alors de
bonnes chances de reconquérir la majorité au Congrès
dès 2010 et le présidence en 2012.
Mais Obama est un
homme intelligent, brillant même, de sorte qu'on peut espérer
qu’il apprendra vite de ses erreurs. (Ce dont n’est jamais parvenu à
faire son prédécesseur.) Souhaitons-le nous!
.
| * |
Dans sa chronique du 10 mars 2009, Thomas
Friedman écrivait: «Le parti républicain se comporte
comme s’il préférerait voir le pays échouer plutôt
que Barack Obama réussir. Rush Limbaugh, le patron de facto
du parti, l’a d’ailleurs dit si clairement que John McCain s’est senti
obligé de dire, à propos d’Obama: “Je ne veux pas qu’il échoue
dans sa mission de restaurer l’économie.” De fait, le parti
républicain est à débattre pour savoir s’il désire
ou non voir le président échouer.»
Source: Thomas Friedman, «This
Is Not a Test. This Is Not a Test», The New York Times, 10 mars
2009. |
.
Ressources: Eric Dash &
Jack Healy, «Stocks
Slide as New Bailout Disappoints», «For
Geithner’s Debut, a Lukewarm Reception», The New York Times,
10 février 2009 ; Jeff Zeleny, «Daschle
Ends Bid for Post; Obama Concedes Mistake», The New York Times,
3 février 2009.
 Ce graphique juxtapose
l’évolution de la valeur de l’indice boursier Dow Jones pour les
années 2008 et 2009. Au début de 2008, l’indice valait
13,000 points, alors qu’un an plus tard, il
ne vaut que 9,000. On observe aussi que sa
valeur a eu tendance à se maintenir durant la première moitié
de 2008, puis à entreprendre une descente durant l’été
qui s’est soldée par un effondrement en octobre. En ce début
d’année 2009, le Dow Jones continue de baisser, atteignant les 8,000
points en février. (Notez la similitude des courbes en début
d’années.)
Ce graphique juxtapose
l’évolution de la valeur de l’indice boursier Dow Jones pour les
années 2008 et 2009. Au début de 2008, l’indice valait
13,000 points, alors qu’un an plus tard, il
ne vaut que 9,000. On observe aussi que sa
valeur a eu tendance à se maintenir durant la première moitié
de 2008, puis à entreprendre une descente durant l’été
qui s’est soldée par un effondrement en octobre. En ce début
d’année 2009, le Dow Jones continue de baisser, atteignant les 8,000
points en février. (Notez la similitude des courbes en début
d’années.) |
.
Obama, le franc tireur
À l’occasion
de sa première conférence de presse en tant que président,
Barack Obama a martelé la nécessité de renoncer à
la petite politique et à la rigidité idéologique.
Il a ainsi rabroué les républicains qui s’opposent à
son plan de relance visant à stimuler l’économie pour plutôt
réclamer de nouvelles baisses d’impôt. «Ce n’est
pas une récession banale, c’est la pire depuis la Grande dépression,
a dit Obama en demandant une fois de plus au Congrès d’adopter sans
délai son plan de stimulation économique.
 Tout en continuant de prêcher une politique non partisane, le président
n’a pas manqué de décocher quelques flèches envers
l’administration Bush et l’idéologie néo-conservatrice des
républicains. «Comme nous l’avons appris très clairement
et définitivement ces huit dernières années, les réductions
d’impôt ne peuvent à elles seules résoudre tous nos
problèmes économiques, particulièrement des réductions
d’impôt qui ciblent les Américains les plus riches.
Cela nous a plutôt conduits à la crise actuelle. Nous
avons essayé cette méthode à maintes reprises et elle
nous a seulement mené en crise.»
Tout en continuant de prêcher une politique non partisane, le président
n’a pas manqué de décocher quelques flèches envers
l’administration Bush et l’idéologie néo-conservatrice des
républicains. «Comme nous l’avons appris très clairement
et définitivement ces huit dernières années, les réductions
d’impôt ne peuvent à elles seules résoudre tous nos
problèmes économiques, particulièrement des réductions
d’impôt qui ciblent les Américains les plus riches.
Cela nous a plutôt conduits à la crise actuelle. Nous
avons essayé cette méthode à maintes reprises et elle
nous a seulement mené en crise.»
«Ce que je
ne ferai pas, c’est d’appliquer à nouveau l’idéologie erronée
des huit dernières années qui nous a en fin de compte plongés
dans la situation actuelle. Cette idéologie a été
appliquée et a échoué… Et lorsque j’entends
la critique de ceux qui ont présidé au doublement de la dette
nationale… eh bien, vous savez…, je ne veux simplement pas qu’ils se mettent
à réécrire l’histoire. J’ai hérité
d'un déficit de plus d’un billion $ et de la crise économique
la plus terrible depuis la Grande dépression.»
Hormis ces pointes,
ce qui frappe, c’est le ton généralement modéré
et la clarté du raisonnement du nouveau président (qu'on
découvre aussi, dans ses longues réponses, comme étant
«verbo-moteur»). Un bel exemple est sa réponse
à la question pertinente d’un journaliste: «M. le président,
selon ce que vous nous dites, vous cherchez à faire redépenser
les consommateurs. Mais n’est-ce pas justement le fait de dépenser
qui nous a mis dans le pétrin?»
«Premièrement,
je ne pense pas qu’il soit exact de dire que ce sont les dépenses
des consommateurs qui nous ont mis dans ce pétrin, a répondu
le président. À l'orgine, ce sont plutôt les
banques qui ont pris des risques inconsidérés avec l’argent
des autres, en se basant sur des valeurs risquées. À
cause d’un formidable effet de levier, à partir duquel pour une
valeur de 1$, les banques pouvaient engager 30$, cela nous a mené
à une crise du système financier. Cette crise a à
son tour débouché sur une restriction du crédit qui
a fait en sorte que les entreprises ne peuvent plus payer leurs employés
et leurs inventaires, ce qui a pour conséquence que tout le monde
s’inquiète de l’avenir de l’économie. Les gens d’affaires
ont donc réagi en réduisant leurs investissements, procédant
à des mises à pied, ce qui aggrave à son tour les
choses.»
«Mais vous
avez un bon point concernant le fait que notre taux d’épargne est
trop bas, de poursuivre le président. Notre économie
a été soutenue par les dépenses des consommateurs
depuis trop longtemps, ce qui ne peut durer. Si tout ce que nous
faisons, c’est de dépenser sans produire de biens, avec le temps,
les autres pays vont finir par se lasser de nous prêter de l’argent.
Et, éventuellement, la fête se terminera…»
«Et de fait,
la fête est terminée!»
Ressources: «Obama’s
Prime-Time Press Briefing», Peter Baker, «Taking
on Critics, Obama Puts Aside Talk of Unity», The New York
Times, 9 février 2009.
.
|
Le dilemme de la surproductivité
Imaginez que vous êtes propriétaire
d’une entreprise de cent employés. Grâce aux plus récentes
technologies que vous venez d’y introduire, vous produisez désormais
autant avec, disons, dix employés seulement. Que faire des
90 autres «excédentaires»? Les mettrez-vous à
pied ou, au contraire, en production? Si vous les gardez, vous pourriez
produire dix fois plus qu’auparavant. Merveilleux, n’est-ce pas?
Mais il vous faudra vendre dix fois plus qu’auparavant…
C’est le dilemme de la surproductivité
qui frappe la société en général et les entreprises
en particulier depuis des décennies. Sans cesse nous parle-t-on
de la nécessité d’améliorer notre productivité
afin de faire face à la concurrence. Évidemment, toute
entreprise qui ne s’améliore pas risque tôt ou tard - et plutôt
tôt que tard - d’être sortie du marché. Même
chose pour les travailleurs. C’est ainsi que toute entreprise ou
travailleur qui n’a pas pris le virage informatique des années 1980-90
est probablement hors marché et sans emploi aujourd’hui. C’est
une réalité implacable, d’autant plus que l’amélioration
de la productivité a entre autres comme bénéfice de
produire davantage de biens à moindre coût, ce dont profitent
tous les consommateurs que nous sommes.
D’un autre côté, il y a le revers
de la surproductivité: la capacité de produire autant avec
une fraction de la main-d’œuvre et donc de créer du chômage,
à moins de pousser à l’augmentation de la consommation.
Récemment, le New York Times apportait un bel exemple de
ce problème: les fabricants de téléphones cellulaires
ont pratiquement saturé leur marché. Ils ont vendu
plus de 4 milliards de cellulaires, équipant de ce fait quasiment
toute la clientèle potentielle. Que faire maintenant pour
conserver leurs capacités de production et leur niveau de ventes?
L’une des solutions évidentes consiste
à offrir un nouveau produit – un «téléphone
intelligent» de ixième génération - et de mener
une campagne de marketing destinée à nous convaincre qu’il
s’agit d’un produit dont on ne peut se passer. Il nous faudrait donc
absolument remplacer notre appareil (encore fonctionnel) par le plus récent
modèle.
Évidemment, lorsque «tout le
monde» se sera procuré cet appareil, les fabricants de téléphones
devront nous convaincre à nouveau de la nécessité
de se procurer le suivant, sous peine de voir s’effondrer leur marché.
Il s’agit là, on l’aura compris, d’une fuite en avant, phénomène
qu’on observe un peu partout. Cette fuite en avant fonctionne jusqu’à
ce qu’on frappe un mur, comme cela s’est produit en 2008 aux États-Unis
dans les marchés de l'immobilier et de l’automobile.
Une roue qui tourne dans les deux sens
Cette course à l’amélioration de
la productivité a plusieurs effets pervers. D’une part, non
seulement nous pousse-t-elle à surconsommer, mais également
à se surendetter. «Achetez aujourd’hui et payez plus
tard», nous propose-t-on. Mais voilà que nous
en sommes rendus, dans bien des cas, à des taux d’endettement qui
dépassent nos revenus annuels. Qui plus est, lorsque survient
une récession et que nombre de personnes perdent leur emploi, ce
surendettement devient catastrophique, non seulement pour ceux couverts
de dettes mais également pour le marché de la surproduction
pour qui la surconsommation est vitale. Ce phénomène
est accentué par le fait que même ceux qui conservent leur
emploi réduisent leur consommation, de crainte de connaître
éventuellement le sort des chômeurs… Voilà qui accentue
d’autant la crise. (On rapporte d’ailleurs que depuis peu les gens se sont
mis à économiser et à rembourser leurs dettes, ce
qui est une excellente chose à terme mais dévastateur en
plein ralentissement économique.)
On se retrouve en quelque sorte à notre
dilemme de départ: si l’ensemble des entreprises sont désormais
capables de produire autant avec moins de main-d'oeuvre et que par conséquent
elles mettent une partie de leurs travailleurs à pied, elles se
privent d’une proportion équivalente de consommateurs potentiels.
Et bien sûr, moins de gens travaillent, moins il y a de consommateurs,
et moins il y a de consommateurs, plus de travailleurs sont à risque
de perdre leur emploi. Ce cercle vicieux, c’est la roue infernale
dans laquelle nous sommes maintenant plongés.
Culs de sac de la productivité
Un autre effet spectaculaire de l’amélioration
des capacités de production s’observe dans le domaine des communications
(au sens large du terme), notamment: médias, musique et culture.
Le développement phénoménal
de l’informatique a fondamentalement transformé ces champs d’activité
comme personne n’aurait pu l’imaginer il y a quinze ans à peine.
Grâce à l’accessibilité à de puissants ordinateurs,
à des logiciels ultra-performants et à de formidables outils
de diffusion (Internet, CD et DVD, etc.), n’importe qui peut désormais
créer et diffuser ses propres produits.
Ainsi, il n’y a guère de concerts ou
de spectacles où le moindre chanteur ou orchestre distribue sa musique
enregistrée sur CD ou DVD maison. (Sur la rue, on croise même
de jeunes musiciens qui vendent leur CD pour 5 $.) De même,
sur Internet, un nombre incalculable de personnes proposent du contenu
(blogues, sites d’information, bulletins les plus divers, etc.) alors que
tous les quotidiens du monde y deviennent accessibles gratuitement.
Même chose du côté du livre, dont le nombre de parutions
a explosé ces dernières années, alors que quiconque
le moindrement habile peut s’autoéditer et vendre ses œuvres sur
Internet.
Résultat: la quantité
de produits d’information et culturels dépasse de beaucoup les capacités
du marché à les absorber. On assiste donc à
l’effondrement des marchés. Alors qu’autrefois, un succès
de librairie se chiffrait à trois mille exemplaires vendus, voilà
que les éditeurs doivent se contenter aujourd’hui d’un millier (et
encore). Coté musique, les ventes couronnant un «disque
d’or» sont passées de 50,000
à 40,000 albums vendus (et encore).
De leur côté, le tirage des quotidiens et magazines (imprimés)
ne cessent de baisser. En conséquence, tous ceux et celles
qui y travaillent en souffrent puisqu’un nombre croissant d’entre eux ne
parviennent plus à vivre décemment de leur labeur.
L’Internet a aussi un autre effet intéressant
mais très pernicieux: répandre la culture de la gratuité.
Pourquoi achèterait-on des journaux, des magazines et des livres
alors qu’il y a tant à lire (gratuitement) sur le net? Pourquoi
achèterait-on de la musique puisqu’on peut la pirater si aisément?
Évidemment, ce faisant, on oublie que les produits que nous consommons
gratuitement sont le gagne-pain de ceux qui les créent. On
oublie qu'à force de «tirer le diable par la queue»,
les entreprises et créateurs cesseront un jour de produire…
L’une des sources assurant la gratuité
des produits distribués sur Internet est la vente de publicités
(ce qui assure également l’essentiel des revenus des journaux et
magazines). Toutefois, non seulement la quantité de l’offre
Internet augmente-t-elle prodigieusement mais, à cause de la sévère
crise économique actuelle, moins d’entreprises seront en mesure
de payer de la publicité. On pourrait dire que la publicité,
c’est un peu comme de la confiture: pour les consommateurs, trop en consommer
devient vite indigeste alors que, pour ceux pour qui cela assure leur revenu,
à force de l’étendre à toujours plus de médias,
on finit par la diluer complètement.
Évidemment, certains tireront leur épingle
du jeu. Quelques-uns, peut-être les plus puissants ou les plus
inventifs, trouveront le moyen de survivre. Cependant, une foule
d’entreprises, de créateurs et de travailleurs seront laissés
pour compte. On court donc le risque qu’au terme de la crise actuelle,
une proportion non négligeable de travailleurs se retrouvera sans
emploi, alors qu’un nombre réduit d’autres sera en mesure de produire
à peu près tout ce dont la société a besoin.
On se retrouvera en quelque sorte dans la situation de notre entreprise
de départ, où une fraction de la main-d’œuvre alimente le
marché avec, en même temps, tous les effets pervers que cette
situation produit.
Comment donc peut-on imaginer s’en sortir? |
.
Deux poids, deux mesures…
Au Congrès
américain, les républicains s’opposent avec vigueur au plan
de relance de 800 milliards $ que tente de faire adopter le nouveau président
démocrate. Selon eux, ce plan équivaut à «dépenser,
dépenser, dépenser…»
Pourtant, lorsqu’en
2003, le président (républicain) George Bush a lancé
leur pays dans l’invasion de l’Irak – une opération qu’on savait
déjà à l’époque comme extrêmement coûteuse
-, ces mêmes républicains n’ont pas regardé à
la dépense. On estime d’ailleurs que le fiasco irakien coûtera
au bas mot de 1 à 3 billions de dollars. (Curieusement, les républicains
s’objectent à toute intervention de l’État dans l’économie
de leur pays… mais pas dans les affaires des autres États.)
On rapporte par
ailleurs qu’offrir un programme d’assurance-santé à tous
les Américains coûterait une centaine de milliards $ annuellement.
Cette somme permettrait entre autres au 48 millions d’entre eux qui n’a
pas les moyens de se payer des soins hospitaliers d’être convenablement
protégés en cas de maladie. Hélas, cette «mesure
socialiste» est considérée trop dispendieuse.
À lire aussi: Bob Herbert,
«Playing
With Fire», The New York Times, 6 février 2009
; Paul Krugman, «On
the Edge», The New York Times, 5 février 2009 ;
Charles Blow, «Watch
the Tone in Washington», The New York Times, 6 février
2009
[[.
Étonnantes statistiques
sur le chômage
Le taux de chômage
en janvier est plus élevé en Ontario qu’au Québec
(8,0% contre 7,7%), de même qu’aux États-Unis par rapport
au Canada (7,6% contre 7,2%). Autrement dit, toute proportion
gardée, il y a davantage de chômeurs en Ontario qu’au
Québec, et plus aux États-Unis qu’au Canada. Ce sont
des situations jamais observées depuis des décennies.
Comme on s’y attendait,
les pertes d’emplois ont été massives en janvier, mais trois
ou quatre fois plus qu’on s’y attendait même. C’est ainsi qu’au
Canada, 129,000 personnes ont perdu leur emploi,
dont 26,000 au Québec et 71,000
en Ontario (ce dernier nombre étant le plus élevé
jamais enregistré par cette province en plus de trois décennies).
Depuis octobre, les pertes d’emploi s’élèvent a 213,000
au Canada.
On peut toutefois
se consoler en constatant que la situation est pire aux États-Unis:
598,000 personnes ont perdu leur emploi en
janvier seulement, et 1,655,000
ces trois derniers mois.
Travail et chômage,
janvier 2009
|
Québec |
O/Q |
Ontario |
C/O |
Canada |
E/C |
États-Unis |
| Population
adulte |
6 405 000 |
1,65 |
10 591 900 |
2,56 |
27 128 100 |
8,65 |
234 739 000 |
| Population
active |
4 181 900 |
1,71 |
7 164 300 |
2,55 |
18 292 100 |
8,40 |
153 716 000 |
|
Emploi |
3 858 500 |
1,71 |
6 594 200 |
2,58 |
16 982 000 |
8,37 |
142 099 000 |
|
Temps plein |
3 142 700 |
1,71 |
5 372 600 |
2,57 |
13 807 800 |
|
n/d |
|
Temps partiel |
715 800 |
1,71 |
1 221 600 |
2,60 |
3 174 200 |
|
n/d |
|
Chômage |
323 400 |
1,76 |
570 100 |
2,30 |
1 310 100 |
8,87 |
11 616 000 |
| . |
|
|
|
|
|
|
|
| Taux d'activité |
65,3 % |
|
67,6 % |
|
67,4 % |
|
65,5 % |
| Taux de
chômage |
7,7 % |
|
8,0 % |
|
7,2 % |
|
7,6 % |
| Taux d'emploi |
60,2 % |
|
62,3 % |
|
62,6 % |
|
60.5 % |
|
.
| Note: |
Le trois facteurs O/Q, C/O et É/C permettent de comparer respectivement
la situation du Québec et de l’Ontario, celle de l’Ontario et du
Canada et celle du Canada et des États-Unis.
Ainsi, la population adulte de l’Ontario est
1,65 fois plus grande que celle du Québec. En outre, la population
active y est encore plus grande (1,71 fois), c’est-à-dire que, toute
proportion gardée, plus d’adultes sont sur le marché
du travail en Ontario qu’au Québec. (Les deux provinces seraient
à égalité si tous les facteurs étaient à
1,65.) De même, il y a un plus grand nombre de personnes en
emploi (1,71 fois) mais encore davantage de chômeurs (1,76 fois).
Si on compare le Canada aux États-Unis,
on observe que la population adulte américaine est 8,65 fois plus
élevée que celle du Canada. Par contre, le nombre de
travailleurs est plus petit (8,40 fois), alors que le nombre de chômeurs
est plus élevé (8,87 fois). |
Sources: Statistique Canada,
Enquête
sur la population active & U.S. Bureau of Labor, Employment
Situation Summary, 6 février 2009.
Gains et pertes d’emplois
au Québec,
en Ontario, au Canada et
aux États-Unis
.
Les trois tableaux de
gauche illustrent les gains (en bleu) et les pertes (en noir) des emplois
au Québec, en Ontario et au Canada de janvier 2008 à janvier
2009. On y observe que pour les dix premiers mois, les gains et les
pertes se succèdent, alors qu’à partir de novembre, l’emploi
plonge dans le noir. À droite, le même tableau pour
les États-Unis révèle que les pertes d’emplois sont
de plus en plus (et dramatiquement) importantes. Contrairement à
notre situation, le marché du travail américain s’effondre.
(Cliquez sur les tableaux pour les agrandir.)
Nombre de travailleurs au Canada et au
Québec
Une autre façon
de suivre l’évolution du marché de l’emploi en cette période
de crise est d’examiner le nombre de personnes qui travaillent d’un mois
à l’autre. Les deux graphiques ci-dessus retracent le nombre
de travailleurs au Canada (à gauche) et au Québec (à
droite) pour les mois d’octobre, de novembre, de décembre et de
janvier des années 2005 à 2009. Ces graphiques montrent
que pour chaque mois, d’année en année, le nombre de travailleurs
augmente… sauf à partir de novembre 2008, où on commence
à voir une baisse. (Au Canada, le nombre de nouveaux travailleurs
avait tendance à augmenter d’une trentaine de mille pour un même
mois d’une année à l’autre. Au Québec, ce nombre augmentait
d’environ cinq mille.)
.
Chômage : une
idée de ce que nous réserve 2009
Les économistes
de la Banque Toronto Dominion estiment que 325,000
personnes perdront leur emploi cette année au Canada. C’est
à la fois peu et beaucoup.
C’est peu en regard
des millions d’emplois qui seront vraisemblablement perdus aux États-Unis.
Déjà, en décembre seulement, 524,000
Américains se sont retrouvés sans travail. Les 325,000
Canadiens qui subiront le même sort tout au long de 2009 donnent
un ordre de grandeur: en décembre, 34,400
Canadiens ont perdu leur emploi. Le taux de chômage aux États-Unis
s’élève déjà à 7,2%, comparativement
à 6,6% au Canada. Depuis le
début de la récession (décembre 2007), 3,6 millions
d’Américains ont déjà perdu leur emploi.
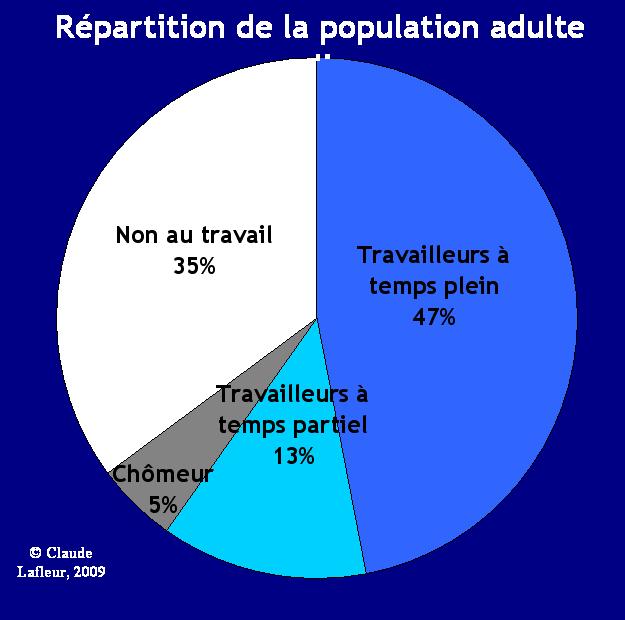 Évidemment, la population du Canada est neuf fois moindre que celle
des États-Unis. Il faut ainsi savoir qu’en décembre
au Canada, 18,3 millions de personnes étaient en mesure de travailler
et que, de ce nombre, 17,1 millions occupaient un emploi (81% à
temps plein, 19% à temps partiel). On comptait 1,2 million
de chômeurs (soit 6,6% de tous les travailleurs). Si les prédictions
de la Toronto Dominion s’avèrent exactes, ce nombre passera à
1,5 million de personnes, pour donner un taux de chômage de 9% en
fin d'année.
Évidemment, la population du Canada est neuf fois moindre que celle
des États-Unis. Il faut ainsi savoir qu’en décembre
au Canada, 18,3 millions de personnes étaient en mesure de travailler
et que, de ce nombre, 17,1 millions occupaient un emploi (81% à
temps plein, 19% à temps partiel). On comptait 1,2 million
de chômeurs (soit 6,6% de tous les travailleurs). Si les prédictions
de la Toronto Dominion s’avèrent exactes, ce nombre passera à
1,5 million de personnes, pour donner un taux de chômage de 9% en
fin d'année.
Sources: Presse Canadienne,
«Environ
325 000 personnes perdront leur emploi, croit la TD», 5 février
2009 ; Statistique Canada, Enquête
sur la population active, U.S. Bureau of Labor, Employment
Situation Summary, 6 février 2009.
.
Prêts à
fonds perdus
Ne nous faisons pas
d’illusions: jamais les entreprises à qui nos gouvernements prêtent
des milliards $ ne nous rembourseront. Pourquoi? Simplement
parce que lorsque le temps sera venu, «on» invoquera que de
tels remboursements équivaudront à des ponctions de milliards
prises à même une économie à peine remise de
la plus grande crise financière de tous les temps. Autrement
dit, rembourser les contribuables que nous sommes sera considéré
comme priver les entreprises des milliards dont elles auront tant besoin
pour reprendre leur croissance. Autant se le dire tout de suite:
chaque milliard «prêté» par nos gouvernements
est à fonds perdus.
.
Marmotte et Londres
sous la neige :
drôle de temps
Lundi matin, 3 février,
deux préoccupations dominent l’actualité du moment: la marmotte
verra-t-elle son ombre, se demandent nombre de médias alors qu’ils
rapportent qu’une chute de neige d'une douzaine de centimètres –
la plus importante en 18 ans -, paralyse Londres.
D'une part, il est
navrant de voir que les médias accordent tant d’importance à
une prétention aussi absurde qu’une marmotte, si elle voit son ombre
en ce jour, annonce encore six semaines d’hiver. Cela revient à
dire que si la matinée est ensoleillée en ce 3 février,
l’hiver durera encore six semaines, mais que si c’est nuageux, il sera
moins long! C’est aussi stupide que de prétendre que: «Le
3 fait le mois si le 5 ne le défait pas…»
Qui plus est, six
semaines d’hiver nous mènent à la mi-mars. Or, depuis
quand l’hiver se termine-t-il plus tôt? En réalité,
les temps froids et enneigés s’étendent généralement
jusqu’à la fin mars. Le fait est, que la marmotte ait vu ou
non son ombre, il nous reste probablement huit semaines d’hiver.
On pourrait toujours
dire qu’il n’y a pas de quoi s’émouvoir de ce que les médias
se préoccupent tant de la marmotte, que ça ajoute «un
peu de poésie» à notre quotidien en cette portion un
peu longue de l’année. Ce serait le cas si ce n’était
de l’importance que ceux-ci y accordent, les principaux bulletins de nouvelles
en parlant, souvent même en tout début (comme si c'était
une véritable information).
Signe des temps climatiques ?
D'autre part, on nous
annonce que Londres a reçu sa plus forte chute de neige en 18 ans
et que, ô grand malheur, les résidents n’ont pu aller travailler.
Il a même été question que la capitale britannique
s’équipe pour faire face à une telle calamité météorologique.
Or, à bien
y penser, une chute de neige qui ne fait que bloquer les transports une
journée ou deux, est-ce si dramatique? Les Londoniens, comme
nous tous, sont-ils à ce point incapables de manquer une journée
de travail pour se reposer ou jouer dans la neige une fois tous les 18
ans? Sommes-nous à ce point conditionnés par le travail
qu’un simple jour manqué soit considéré comme une
catastrophe nationale rapportée mondialement?
On peut néanmoins
se consoler en pensant que le fait que Londres soit ensevelie sous la neige
aurait autrefois pris une tout autre connotation.
En effet, si aujourd’hui
on s’inquiète des conséquences du réchauffement de
la planète, il y a une trentaine d'années, on redoutait plutôt
de subir une ère glacière. Eh oui, dans les années
1960-1970, on craignait les conséquences d’une
baisse marquée
des températures qui replongerait le monde dans une glaciation provoquant
bouleversements sociaux, famines et pertes de vie d’ici l’an 2000.
Ainsi donc, si nous
vivions encore avec une telle crainte, la chute de neige de Londres nous
aurait été présentée comme un signe de plus
des conséquences que nous réservent les changements climatiques.
Évidemment, dans le contexte actuel, personne ne fait un tel lien.
Toutefois, ce sera le cas si, l’été prochain, une grande
ville subit la plus importante canicule de ses 18 dernières années.
Là, l’interprétation qu’on fera du phénomène
sera toute différente… malgré le fait que des écarts
météorologiques «jamais vus en 18 ans» surviennent
normalement
de temps à autres.
Ressources: Mali Ilse Paquin, «Londres
paralysé par la neige», La Presse, 3 février
2009 ; Presse Canadienne, «L'hiver
durera encore six semaines... foi de marmotte», Allison Jones,
«Ne
rangez pas vos pelles, prédisent les marmottes», Presse
Canadienne, Louis Potvin, «Le
verdict d'Ernest: six semaines d'hiver», Le Quotidien,
2 février 2009.
.
Se libérer du
joug du passé
L’Histoire est
implacable, écrit le journaliste Roger Cohen. Pourtant,
on parvient parfois à s'en affranchir. C’est ainsi qu’après
1945, la France et l’Allemagne ont sû se libérer du cycle
infernal de la guerre. Même chose du côté polonais
et allemand. La Chine et le Japon ne s’aiment guère, mais
ils commercent entre eux.
Seul au Moyen-Orient,
la mort triomphe. Comme l’a dit le poète israélien
Yehuda Amichai, à Jérusalem, ce sont les morts qui votent.
Leur soif de sang est insatiable. Leurs tombaux ne connaîtront
jamais la paix. Depuis 1948, depuis la fondation d’Israël, la
vengeance domine les mouvements nationaux juifs et palestiniens.
Israël,
soutenu par les États-Unis, avait l’intention de montrer que le
Hamas pouvait être soit contrecarré ou anéanti, au
lieu de chercher à faire en sorte que, comme avec l’Organisation
de libération de la Palestine, il soit amené à contribuer
à la solution. C’est une erreur stratégique.
Même si trois cents de ses militants et dirigeants ont été
tués, le Hamas a été renforcé par la plus récente
mésaventure d’un autre leader israélien faible.
D'après Roger Cohen,
«Eyeless in Gaza»,
The
New York Review of Books, Volume 56, Numéro 2, 12 févrer
2009.
.
Fin de la guerre au
terrorisme ?
«À l’occasion
de sa première entrevue télévisée, accordée
au réseau d’information Al Arabiya, le président Obama a
laissé filer la grande nouvelle: la guerre au terrorisme est terminée»,
écrit Roger Cohen, chroniqueur au New York Times.
«Oui, poursuit-il,
la confrontation globale du vous-êtes-pour-ou-contre-nous lancée
par George Bush et pour laquelle un Occident soi-disant épris de
liberté s’opposait aux forces occultes et mal définies qui
se réunissaient sous la bannière de l’islamofachisme (d’Al
Qaeda à des éléments de la lutte nationale pour la
Palestine) est terminée… Reste maintenant à démantler
les organisations terroristes, ce qui n’est pas une guerre, mais un défi
stratégique.»
«L’abandon
par le nouveau président de la doctrine Bush de l’après 11
septembre est un progrès remarquable, indique Roger Cohen.
Bien que ça ne règle rien pour l’instant, cela ouvre la voie
à un rapprochement avec le monde musulman longtemps considéré
dans le camp de ceux qui sont “contre nous”. Face à un tel
fossé manichéen, rien qui vaille ne pouvait survenir sur
les fronts israélo-palestinien, afghan ou iranien.»
Obama a néanmoins
déclaré qu’il «distinguait clairement les organisations
telles qu’Al Qaeda – qui préconisent la violence et la terreur et
qui agissent en conséquence – de ceux qui pourraient être
en désaccord avec mon administration et avec certaines de nos actions,
ou qui pourraient avoir des points de vue différents sur comment
leur pays pourrait se développer. Nous pouvons être
en désaccord tout en se respectant», d’insister le président.
«Son ton représente
un changement déterminant, estime Cohen. Il fait preuve de
subtilité, de respect, d’autocritique et d’équilibre, tandis
que celui de l’administration Bush était cinglant, offensant, agressif
et biaisé en adhérant à une politique du Israël-ne-peut-faire-quoi-que-ce-soit-de-mal.»
Obama a décrit
le premier séjour en Moyen-Orient de son envoyé spécial,
George Mitchell, comme étant une mission d’écoute, «car
trop souvent, les États-Unis commencent par dicter», a-t-il
noté.
«C’est là
un bond idéologique prodigieux pour un leader américain,
considère le chroniqueur du New York Times, de la doctrine
de suprématie de l’après-guerre froide à une nouvelle
doctrine d’inclusion que requiert la mondialisation.»
Le fait est que
Barack Obama fait preuve d’un grand courage et d’audace en envoyant son
émissaire au Moyen-Orient dès le début de sa présidence.
D’habitude, ses prédécesseurs ont tenté de se maintenir
à distance de ce bourbier. Obama réussira-t-il un tant
soit peu à faire progresser la paix au Moyen-Orient? Si oui,
cela pourrait lui valoir un jour le Nobel de la Paix. Quoiqu’il en
soit, on pourra presque sous peu lui décerner le Nobel du courage…
Source: Roger Cohen, «After
the War on Terror», 29 janvier 2009. Voir aussi: Thomas
Friedman, «The
5-State Solution», The New York Times, 27 janvier 2009.
.
À quoi sert la
vaccination
Certains contestent
vivement l’utilité des vaccins, particulièrement la vaccination
massive des populations et surtout celle des enfants. Sans vouloir
dire qu’il n’y a pas de question à se poser ni de débat à
faire, il ne faut tout de même pas non plus rejeter la vaccination,
car ce serait oublier ce que nous vivions avant ses bienfaits.
Pour se donner une
idée de ce que pouvait être le monde avant la vaccination,
prenons l’exemple contemporain de ce que fait la Global Aliance for
Vaccine and Immunisation (GAVI), une alliance mise sur pied en 1999
par un don de 750 millions $us provenant de la Fondation Bill & Melinda
Gates.
Chaque année, rapporte
l’Organisation mondiale de la santé, 530,000
enfants décèdent de maladies infectieuses. Or, la GAVI
en a sauvé 3,4 millions grâce à la vaccination de 213
millions d’enfants.
Cette alliance comprend
l’UNICEF, l’OMS, la Fondation Gates, la Banque mondiale, plusieurs gouvernements
(donateurs et receveurs), des fabricants de vaccins et des ONG. Elle
s’est engagée à investir 3,7 milliards $ dans divers programmes
de santé publique menés dans 75 pays entre 2000 et 2015.
Pour en savoir plus: GAVI Alliance.
.
Le retour des fous de
dieu
Les talibans n’ont
pas fini de sévir, rapporte le New York Times, qui décrit
l’imposition par ces fous de dieu de croyances insensées dans une
région autrefois prospère et libérale du Pakistan.
«Chaque soir
à 8 heures, les résidents terrifiés de Swat, une splendide
vallée pittoresque située à 150 km des trois principales
villes du Pakistan, se rassemblent autour de leur poste radio, rapporte
le quotidien. Ils savent que tout absent risque le fouet, sinon même
d'être décapité.»
«La plupart
du temps, le dirigeant local des talibans, Shah Doran, énonce à
la radio la plus récente litanie des actes “non islamiques” désormais
interdits, comme regarder la télévision par câble,
chanter et danser, critiquer les talibans, se raser la barbe et permettre
aux filles d’aller à l’école. Il révèle
aussi le nom des personnes que les talibans viennent d'exécuter
pour avoir désobéi à leurs diktats, ainsi que ceux
qu’ils projettent d'assassiner.»
Les talibans imposent
ainsi aux 1,3 million d'habitants de la vallée leur interprétation
sadique de l’Islam, procédant à des décapitations
publiques, à des assassinats, à la répression sociale
et culturelle, ainsi qu’à la persécution systématique
des femmes. Le quotidien new-yorkais rapporte en outre que les forces
de l’ordre locales sont si terrorisées que plusieurs policiers ont
publié des annonces afin de faire savoir à tous qu’ils ne
sont plus en fonction. (Les autres, qui résistent, sont décapités.)
Ceux et celles qui
d'entre nous se demandent pourquoi «nous» sommes en Afghanistan
doivent se rappeler que c’est pour combattre le régime le plus abject
que l’humanité a connu et, surtout, pour empêcher le retour
de ces fous de dieu en ce 21e siècle.
Durant l’époque
où ils ont sévi (de 1994 à 2001), l'Afghanistan vivait
sous la domination de 30,000 à 40,000
talibans, rapporte Wikipédia. «Le théâtre, le
cinéma et la télévision étaient interdits,
écrit-on. La possession d'appareils photographiques et de magnétoscopes
devint illégale. Les talibans brûlaient les instruments de
musique et les cassettes, frappaient et emprisonnaient les musiciens, interdisaient
la danse.»
De plus, les Afghans
devaient peindre en blanc les vitres de leurs maisons pour ne pas que les
femmes à l'intérieur soient visibles. Des expéditions
punitives étaient organisées afin de détruire les
téléviseurs et magnétoscopes, et pour déchirer
les photos de famille. Les talibans s'assuraient que personne n'écoutait
de la musique dans leur maison ni au cours des mariages.
Toute représentation
humaine était illégale, même les poupées des
petites filles. L'enseignement secondaire leur était d'ailleurs
interdit. Les femmes furent exclues du marché de l'emploi et devaient
être entièrement couvertes par une burqa et ne jamais quitter
leur maison sans être accompagnées de leur mari ou d'un parent
proche. Les hommes devaient porter une barbe d'au moins 10 centimètres
(la longueur étant vérifiée dans la rue). Le fouet,
l'amputation et la lapidation étaient couramment appliqués.
Les femmes jugées pour crimes d'adultère étaient lapidées,
les homosexuels étaient condamnés à mort...
Sources: Richard A. Oppel Jr,
«Radio
Spreads Taliban’s Terror in Pakistani Region«, The New York
Times, 24 janvier 2009 ; Les Taliban
selon Wikipédia.
.

Départ fulgurant pour
le président Obama
En l’espace
de trois jours seulement comme président, Barack Obama a pris davantage
de décisions importantes que tout autre de ses prédécesseurs.
Ainsi, mardi
20 janvier, il n'attend pas la fin de sa première journée
comme 44e président des États-Unis pour suspendre les procédures
judiciaires d'exception du tribunal de Guantánamo créé
pour «juger» les suspects de terrorisme. Il ordonne aussi
la suspension des décrets émis par l’administration Bush,
le temps de leur révision légale et politique.
Le lendemain, il
convoque ses conseillers à la sécurité nationale et
militaires pour discuter de la façon de retirer les troupes d’Irak,
de renforcer celles en Afghanistan, d’entreprendre la fermeture du camp
de concentration de Guantánamo. Il lève aussi l'interdiction
imposée par l’administration Bush de financement fédéral
pour les organismes internationaux pratiquant ou facilitant l'avortement.
Jeudi, 22 janvier.
le président Obama annonce la fermeture du centre de détention
de Guantánamo «dans un délai d'un an» ainsi que
toute autre prison secrète de la CIA à l'étranger.
Il édicte en outre de nouvelles règles pour un gouvernement
éthique et transparent, ainsi que pour limiter l’accès des
lobbyistes à son administration, tout en imposant plus de transparence
aux agences gouvernementales.
Vendredi, 23 janvier,
il rétablit la prééminence de la Convention de Genève
à l'égard des présumés terroristes et restaure
l'autorité des procédures militaires d'interrogatoire qui
excluent la torture. Il assigne aussi un envoyé spécial
au Proche-Orient (George Mitchell) et un autre au Pakistan et en Afghanistan
(Richard Holbrooke). Il promet ainsi que «la droiture morale
sera désormais le fondement et le phare du leadership américain
dans le monde», suscitant une ovation de la part des hauts fonctionnaires
de la diplomatie américaine.
Il est difficile
d'imaginer désaveux plus complets et cinglants des huit années
de l'administration Bush.
Sources: Sheryl Gay Stolberg,
«On
Day One, Obama Sets a New Tone» ; Mark Mazetti, «Obama
to Shut Guantánamo Site and C.I.A. Prisons» ; Jeff Zelony,
«Oath
Is Administered Once Again » ; Scott Shane, «Obama
Issues Directive to Shut Down Guantánamo» ; Éditorial,
-The President
Orders Transparency» ; Scott Shane, «Obama
Orders Secret Prisons and Detention Camps Closed» ; Scott Shane,
Mark Mazetti & Helene Cooper, «Obama
Reverses Key Bush Security Policies» ; Mark Landler, «Appointing
Emissaries, Obama and Clinton Stress Diplomacy» ; Peter Baker,
«Obama
Reverses Rules on U.S. Abortion Aid», The New York Times
21, 22, 23 et 24 janvier 2009.
Voir «la suite»:
John Broder & Peter Baker, «Obama’s
Order Is Likely to Tighten Auto Standards» (26 janvier) ; Editorial,
«New
Day on Climate Change» (26 janvier) ; Alan Cowell, «Obama
Interview Signals New Tone in Relations With Islam» & «Obama
Signals New Tone in Relations With Islamic World» (27 janvier),
Sheryl Gay Stolberg, «Obama
Signs Equal-Pay Legislation» (29 janvier)), Sheryl Gay
Stolberg & Stephen Labaton, «Obama
Calls Wall Street Bonuses ‘Shameful’» (29 janvier), David Stout,
«Obama
Moves to Reverse Bush’s Labor Policies» (30 janvier), Edmond
Andrews & Vikas Bajaj, «U.S.
Plans $500,000 Cap on Executive Pay in Bailouts» (3 février),
The
New York Times.
.
Le président
Obama rejette la doctrine Reagan-Bush !
.
 À l’occasion du discours inaugurant sa présidence, Barack
Obama surprend tout le monde en dénonçant directement la
doctrine néo-conservatrice des présidents Reagan et Bush
fils qui préconise que les États-Unis peuvent résoudre
tous leurs problèmes seuls et par la force. Comme le relate
en éditorial le New York Times: «En vingt minutes,
il a balayé huit années de faux semblant et de mauvaises
politiques du président George Bush pour promettre un retour aux
valeurs les plus chères des États-Unis.»
Les observateurs n’ont d’ailleurs pas manqué d’imaginer que «W»,
assis à quelques mètres du nouveau président, devait
grincer des dents.*
À l’occasion du discours inaugurant sa présidence, Barack
Obama surprend tout le monde en dénonçant directement la
doctrine néo-conservatrice des présidents Reagan et Bush
fils qui préconise que les États-Unis peuvent résoudre
tous leurs problèmes seuls et par la force. Comme le relate
en éditorial le New York Times: «En vingt minutes,
il a balayé huit années de faux semblant et de mauvaises
politiques du président George Bush pour promettre un retour aux
valeurs les plus chères des États-Unis.»
Les observateurs n’ont d’ailleurs pas manqué d’imaginer que «W»,
assis à quelques mètres du nouveau président, devait
grincer des dents.*
Dans son allocution,
le président Obama a entre autres lancé: «En ce jour,
nous sommes réunis parce que nous avons choisi l’espoir plutôt
que la peur, l’unité plutôt que la division et la discorde.»
Il a aussi dit qu’il allait «redonner sa place à la science»
ainsi que permettre aux «merveilles de la technologie» de servir
à améliorer la qualité des soins de santé.
«En ce jour,
a-t-il poursuivi, nous sommes réunis pour mettre fin à la
mesquinerie, aux fausses promesses, aux récriminations et aux dogmes
dépassés qui, depuis trop longtemps déjà, minent
notre politique.
«La question
qui se pose n’est pas de savoir si notre gouvernement est trop gros ou
trop petit, mais s’il fonctionne, s’il aide les familles à se trouver
un emploi décent, à obtenir des soins abordables et à
s’assurer une retraite convenable.
«Et ceux qui
d’entre nous géront les deniers publics auront des comptes à
rendre. Ils devront dépenser de façon intelligente,
mettre fin au gaspillage et conduire les affaires de l’État au grand
jour, parce c’est la seule façon de restaurer la confiance que la
population doit avoir envers le gouvernement… Notre nation ne peut
pas prospérer en ne favorisant que les plus riches.
«En ce qui
concerne notre sécurité nationale, nous rejetons comme faux
le choix entre la sécurité et nos idéaux… C’est
ainsi que nous disons à tous ceux qui nous regardent de par le monde
et aux gouvernements, sachez que les États-Unis sont l'ami de chacune
des nations et de chacun des hommes, des femmes et des enfants qui cherchent
à construire un avenir de paix et de dignité, et que nous
sommes prêts à reprendre notre place sur la scène internationale.
«Rappelons-nous
que les générations qui nous ont précédés
ont vaincu le fascisme et le communisme non pas uniquement à l’aide
de missiles et de chars d’assaut, mais également en étant
unis et dotés de profondes convictions.
«Ils avaient
compris que notre seule puissance ne peut pas nous protéger contre
tout, pas plus qu’elle nous donne le droit de faire ce qu’il nous plaît.
Au contraire, ils savaient que notre pouvoir s’accroît par son utilisation
restreinte. Notre sécurité vient de la justesse de
notre cause, de la force de notre exemple, de notre propension à
faire preuve d'humilité et de modération.
«Avec nos
alliés et nos anciens ennemis, nous allons travailler sans relâche
pour atténuer la menace nucléaire et pour faire reculer le
spectre du réchauffement de la planète. Avec le monde
musulman, nous chercherons une nouvelle façon de progresser, basée
sur nos intérêts communs et sur le respect mutuel…»
 En terminant son discours, Barack Obama souligne qu’il a la chance de devenir
président d’un pays où son père, il y a 60 ans, n’aurait
probablement pas pu se faire servir dans un restaurant local à cause
de la couleur de sa peau!
En terminant son discours, Barack Obama souligne qu’il a la chance de devenir
président d’un pays où son père, il y a 60 ans, n’aurait
probablement pas pu se faire servir dans un restaurant local à cause
de la couleur de sa peau!
De conclure le New
York Times: «Après plus de sept années de recours
à la peur et à la xénophobie par M. Bush pour justifier
une guerre aussi désastreuse qu’inutile et pour bafouer les droits
fondamentaux de tout Américain, il est enivrant d’entendre M. Obama
rejeter ”comme faux le choix entre notre sécurité et nos
idéaux“.»
.
SourceS: Barack
Obama’s Inaugural Address ; éditorial, «President
Obama» ; Peter Baker, «After
a Day of Crowds and Celebration, Obama Turns to Sober List of Challenges»,The
New York Times, 20 janvier 2009.
.
Ce 20 janvier 2009

Une foule estimée à
1,8 million de personnes (la population de Montréal)
s’est rassemblée sur
la grande esplanade de Washington D.C.
Aujourd’hui règne
une atmosphère de fébrilité comme on en connaît
rarement. Tout le monde a l’impression de vivre une journée
historique, le genre de jour dont on se souviendra longtemps: on tourne
enfin le dos aux années Bush, alors qu’un nouveau président,
le premier afro-américain, prendra les rennes du pouvoir.
Il flotte un parfum d’euphorie.
Cette euphorie me
rappelle celle d’un dimanche d’il y a très exactement 39½
ans. Dans six mois, le 20 juillet, nous célébrerons
les 40 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Il y régnait
ce dimanche-là une fébrilité comparable à celle
d'aujourd'hui puisque tout le monde avait la nette impression – avec raison
- de vivre un moment historique. L’équipage d’Apollo
11 allait-il réussir son alunissage prévu pour l’après-midi?,
se demandait-on en matinée. Et puis, les deux astronautes
allaient-ils pouvoir marcher sur la Lune sans problème? Évidemment,
39½ ans plus tard, tous ceux et celles qui ont vécu l’événement
se souviennent de l'atmosphère de ce jour-là.
En ce mardi 20 janvier
2009, on se pose un peu le même genre de questions. Comment
se passeront les cérémonies d’assermentation de Barack Obama?
Quels seront les premiers mots du nouveau président, quel message
voudra-t-il nous livrer? Et surtout peut-être: est-ce que tout
se passera bien? (Qui ne craint pas l’attentat, comme si on ne pouvait
croire qu’un noir deviendra président des États-Unis.)
Quoi qu’il arrive,
il est vraisemblable qu’on se remémorera longtemps cette journée
historique. Espérons que, un peu comme en juillet 1969, ce
sera un «petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour
l’humanité»!
.
Dernière journée
de l'administration Bush !
Ce lundi, 19 janvier
2009, marque la dernière journée des huit années cauchemardesques
de George Bush fils. Comme l'écrit si justement Myriam Berbe,
«George W. Bush laisse à son successeur un pays à genoux,
menant deux guerres, en Irak et en Afghanistan, et se débattant
dans la plus grave crise financière depuis la Grande dépression.»
«Plus
de 37 millions d’Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté,
poursuit-elle, et 46 millions sont dépourvus de couverture médicale
en raison de l’explosion des prix des assurances. Georges W. Bush a voulu
une société de propriétaires, mais la déréglementation
du crédit a déclenché un véritable désastre.
Plus de 4 millions d’Américains étranglés par la crise
des crédits hypothécaires à risques («subprimes»)
perdront bientôt leur logement.
«Entre les
baisses d’impôts qui ont surtout profité aux plus riches et
l’augmentation des dépenses militaires, George W. Bush a vidé
les caisses de l’Etat fédéral. Barack Obama se retrouve avec
un déficit budgétaire vertigineux de 1,200
milliards de dollars pour l’exercice 2008/2009. Du fait de la récession,
le taux de chômage se situe désormais à 7,2% de la
population active, son niveau le plus haut depuis 1983. Sur l’ensemble
de l’année 2008, l’économie américaine a perdu 2,6
millions d’emplois, dont un million pendant les deux derniers mois de 2008.»
Source: Myriam Berber, «Obama,
44e président des États-Unis : une investiture sur fond de
récession», Radio France International, 19 janvier 2009.
La stratégie (toute
simple) du futur président Obama
.
|
Mon travail, à partir
de mon discours inaugural et durant les mois qui suivront, sera simplement
d’expliquer aussi clairement et franchement que possible ce qui se passe
au juste et les meilleures idées mises de l’avant pour faire face
aux défis. Si j’y parviens, j’ai confiance que nous serons
unis pour résoudre les problèmes. |
|
- Le président-élu Barack Obama,
17 janvier 2009
(en entrevue sur les ondes de MSNBC) |
.
Un autre coup d’épée
dans l’eau
L’automne dernier,
le Congrès américain a débloqué une somme de
700 milliards $us pour stimuler les banques à prêter à
ceux qui en ont besoin (dont les entreprises qui utilisent le crédit
pour fonctionner ou pour se développer). L’administration
Bush espérait ainsi remettre en marche la «roue de l‘économie»
bloquée à la suite de l’effondrement des marchés hypothécaires
et boursiers. Jusqu’à présent, la moitié de
ces 700 milliards $ aurait été remise aux banques.
Qu’ont-elles fait de ces deniers publics?
Mike McIntire, du
New
York Times, rapporte que dans la plupart des cas, les banquiers ont
simplement placé ces fonds «en banque». C’est
ainsi que Walter Pressey, président de la Boston Private Wealth
Management (récipiendaire de 154 millions $), expliquait candidement:
«Avec ce capital en main, non seulement avons-nous confiance de traverser
la récession, mais que nous serons aussi en bonne position pour
profiter des occasions qui se présenteront à nous lorsque
la récession sera passée.»
Somme toute, les
banquiers se comportent comme toute personne prudente qui reçoit
du gouvernement un chèque-cadeau. Dans le contexte actuel
de grande incertitude économique, rares seraient en effet ceux qui
dépenseraient ce cadeau «pour le plaisir». La
plupart d’entre nous mettrait soit de côté la somme ou rembourserait
une partie de ses dettes.
C’est justement
ce qui s’est passé le printemps dernier lorsque l‘administration
Bush a fait parvenir un chèque-cadeau à chaque contribuable
américain – un programme de 50 milliards $ qui visait à convier
les consommateurs à dépenser pour stimuler l’économie.
Évidemment, le seul fait de recevoir ainsi un chèque du gouvernement
a lancé le signal que la situation économique était
grave, accentuant d’autant la crainte en l’avenir. Ce fut le premier des
nombreux coups d’épée dans l’eau visant à stimuler
l’économie à coups de centaines de milliards $ de fonds publics.
D'après : Mike McIntire,
«Bailout
Is a Windfall to Banks, if Not to Borrowers», The New York
Times, 17 janvier 2009.
.
La « guerre au
terrorisme » :
une stratégie qui
a renforcé le terrorisme
Le secrétaire
britannique aux affaires étrangères, David Miliband, déclare
que l’utilisation de l’expression «guerre au terrorisme», si
chère au président Bush depuis les attentats du 11 septembre,
a été une erreur monumentale puisqu’elle a aidé des
groupes terroristes disparates à faire cause commune contre l’Occident.
C’est la première fois qu’un ministre britannique dénonce
aussi clairement le discours de George Bush.
«Nous avons
aidé les terroristes à s’unir pour mener un combat simple
contre nous, entre le bien et le mai, dit-il. Nous aurions plutôt
dû traiter leurs prétentions en montrant à quel point
il s’agit de mensonges.»
Qui plus est, «Le
discours de “guerre au terrorisme” a fait croire que la seule façon
de répondre à cette menace était militaire: trouver
et tuer les extrémistes.» Le chef de la diplomatie britannique
fait ainsi écho aux propos du général américain
David Petraeus, qui a réalisé que les Américains ne
pourraient pas en Irak «résoudre par la force les problèmes
d’insurrection et de guerre civile».
M. Miliband considère
plutôt que les démocraties occidentales doivent combattre
le terrorisme en mettant de l’avant leurs valeurs et le respect des lois,
et surtout pas subordonner celles-ci à une «guerre au terrorisme»
menée au mépris de toute règle (comme l'a justement
fait l'administration Bush).
Comme il le dit
si bien, «les historiens jugeront un jour si nous avons bien ou mal
fait». On peut même déjà parier qu’une
fois que la «guerre au terrorisme» sera gagnée (faute
de combattants), on jugera sévèrement les excès
de nos dirigeants qui, par exemple, imposent de folles mesures de sécurité
aux aéroports tout en dépensant des milliards $ en contrôles
inutiles.
Pour paraphraser
Bin Laden, chaque fois qu’Al Qaeda dépense un dollar pour émettre
de vagues menaces, nos gouvernements réagissent en en dépensant
des millions.
Source: Julian Borger, «David
Miliband expands on criticism of 'war on terror' phrase» et voir
aussi: Mark Tran, «War
on terror – a term that no longer applies», The Guardian,
15 janvier 2009.
.
De moins en moins de
guerres dans le monde
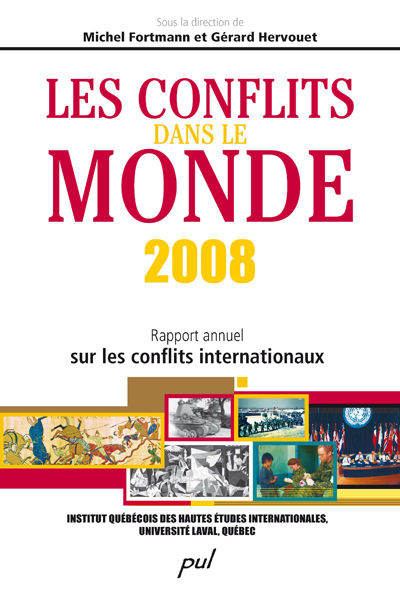 Contrairement à ce qu’on pense généralement, nous
vivons dans un monde où il y a de moins en moins de guerres.
C’est du moins ce que constate Michel Fortmann, professeur au Département
de science politique de l'Université de Montréal et spécialiste
de l’étude des conflits. En collaboration avec Gérard
Hervouet, il a dirigé la publication de Les conflits dans le
monde 2008, publié aux Presses de l'Université Laval.
Contrairement à ce qu’on pense généralement, nous
vivons dans un monde où il y a de moins en moins de guerres.
C’est du moins ce que constate Michel Fortmann, professeur au Département
de science politique de l'Université de Montréal et spécialiste
de l’étude des conflits. En collaboration avec Gérard
Hervouet, il a dirigé la publication de Les conflits dans le
monde 2008, publié aux Presses de l'Université Laval.
«Les trois
ou quatre dernières années ont révélé
une tendance que je dirais plutôt positive, a-t-il rapporté
sur les ondes de Radio-Canada. Contrairement à ce que montrent
en général les médias - le mauvais côté
des choses: le sang, les victimes, les réfugiés, etc. –,
ce qu’on constate en fait, c’est une diminution très marquée
du nombre de confits dans le monde.»
«Cette tendance
remonte aux années 1990, poursuit-il. C’est-à-dire
qu'au début des années 1990, nous comptions une trentaine
de conflits majeurs dans le monde - des conflits qui font plus de mille
morts en tant que tels. Or, aujourd’hui, nous sommes à environ
une quinzaine. On assiste donc à une diminution de 50% du
nombre de conflits dans le monde au cours des 18 dernières années.»
Qui plus est, selon
ce spécialiste, les guerres tendent à faire moins de victimes:
«Le nombre de morts du fait de guerre (sur le champ de bataille)
a diminué de 99% depuis les années 1950», dit-il.
Comment expliquer
de telles diminutions? Selon Michel Fortmann, plusieurs facteurs
joueraient. D’une part, il y aurait le fait que la communauté
internationale intervient dans les conflits et qu’elle ne les laisse plus
ni dégénérer ni perdurer. «Encore là,
dit-il, la vision que nous avons de l’ONU, des casques bleus et de ce qu’ils
font est souvent négative, dit-il. Or, il semble que depuis
18 ans, l’action de la communauté internationale pour résoudre
les conflits et rebâtir les sociétés par après
est beaucoup plus efficace qu’on le pense.»
Une deuxième
explication serait le nombre croissant de démocraties. Alors
que dans les années 1970, moins de la moitié des pays était
démocratique, aujourd’hui, c’est le contraire. «Et la
thèse veut que plus il y aura de démocraties dans le monde,
plus la paix régnera», résume le chercheur.
Enfin, et surtout
peut-être, nous assisterions à un «changement de paradigme».
C’est-à-dire que la guerre, autrefois si valorisée et considérée
comme une activité normale des sociétés, est devenue
ces dernières décennies non seulement de moins en moins glorifiée
mais de plus en plus dénoncée. «La guerre en
tant qu’activité sociale est de moins en moins acceptable, au moins
aux yeux d’une grande partie de la population», souligne M. Fortmann.
Ainsi donc, alors
que durant des millénaires, les populations ont vécu sous
le joug de dirigeants qui faisaient à leur guise – y compris en
menant des guerres à tout vent -, voilà que les populations
vivant en démocratie s’opposent vigoureusement aux ambitions guerrières
de leurs dirigeants politiques.
Évidemment,
il peut sembler étonnant - pour ne pas dire incroyable -, de penser
que nous vivons réellement dans un monde où il y a de moins
en moins en guerre. On a la même impression au sujet de la
violence domestique (homicides, viols, vols et agressions). Pourtant,
dans un cas comme dans l’autre, les chiffres contredisent le discours si
souvent véhiculé par les médias. À lire donc:
Les
conflits dans le monde 2008.
Source: Michel Fortmann interviewé
par Stéphane Garneau à Pourquoi pas dimanche, Première
chaîne de Radio-Canada, 11 janvier 2009, vers 9h45.
Voir: Michel Fortmann et Gérard
Hervouet,
Les
conflits dans le monde 2008, Rapport annuel sur les conflits internationaux,
Presses de l'Université Laval, novembre 2008.
.
Étonnantes leçons
du passé
À l'heure
où des terroristes jouent avec la vie de leurs otages, où
la crainte d'une Troisième Guerre mondiale fait flamber les monnaies,
où brûlent les ambassades, où, dans de nombreux pays,
retentissent des bruits de bottes, c'est avec épouvante que nous
regardons les titres des journaux. Les cours de l'or, ce baromètre
de la peur, battent tous les records. Les banques tremblent.
L'inflation se déchaîne. Et les gouvernements sont frappés
de paralysie ou de crétinisme.
Devant ce spectacle,
le choeur des Cassandres fait résonner l'air de son chant d'apocalypse.
L'homme de la rue soupire «le monde est devenu fou» tandis
que les experts recensent tous les courants qui nous mènent à
la catastrophe.»
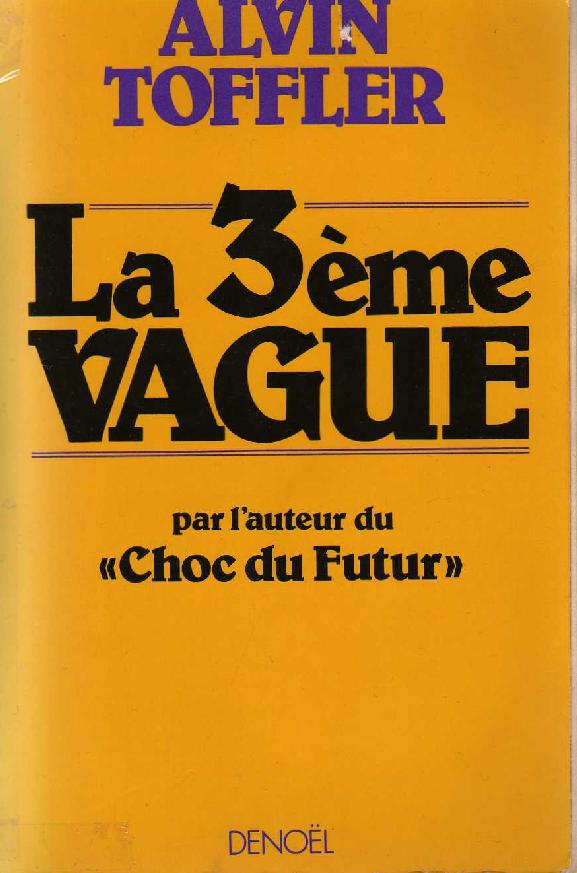 Curieux texte, n’est-ce pas? On dirait presque, à quelques
détails près, une description de notre époque. Pourtant,
cette vision a été rédigée il y a trente ans
et décrit le monde tel qu’on pouvait le percevoir à la fin
des années 1970.
Curieux texte, n’est-ce pas? On dirait presque, à quelques
détails près, une description de notre époque. Pourtant,
cette vision a été rédigée il y a trente ans
et décrit le monde tel qu’on pouvait le percevoir à la fin
des années 1970.
Il s’agit
des deux premiers paragraphes du livre La 3ème Vague rédigé
par le journaliste et célèbre futurologue Alvin
Toffler. Dans cet ouvrage, qui met en perspective le monde dans
lequel on vit (ou plutôt celui d’il y a 30 ans), l'auteur trace les
grandes tendances de société qui mènent aux années
2000. (Un ouvrage fascinant à lire trente ans plus tard.)
Étonnamment,
Toffler se demande si le monde «n’est pas devenu fou» et parle
des «bruits de bottes», de la paralysie et du crétinisme
de nos gouvernements. Voilà qui résonne puissamment
en ce début de 2009, alors que «les bottes» israéliennes
menacent d’envahir la Palestine. Heureusement, on ne nous parle pas
encore d'apocalypse ni de fin du monde, bien que l’ampleur de la crise
économique qu'on connaît a de quoi inquiéter.
Encore une fois,
on a l'impression de se retrouver placé devant le «crétinisme»
puisque le mouvement Hamas, qui contrôle la Bande de Gaza, a repris
ses tirs de roquettes sur le sud d’Israël. Qu’espère-t-il
retirer en menant des attaques aussi futiles?, se demande-t-on. Et
Israël, comme d’habitude, réagit avec une force exagérée:
pour chaque Israélien victime d’une roquette du Hamas, des dizaines
de Palestiniens en paieront le prix. Qu’espère donc obtenir
Israël en envahissant la Bande de Gaza étant donné que
la force, si intense soit-elle, ne vient jamais à bout de quoi que
ce soit? Voilà qu'on se retrouve à nouveau devant
le «crétinisme» de certains de nos dirigeants.
Le 1er janvier 2009
marque incidemment un anniversaire intéressant: les 50 ans de la
révolution cubaine, le renversement du régime Batista par
les troupes de Fidel Castro. Les dirigeants américains n’ayant
jamais digéré cette prise de pouvoir, ils imposent depuis
lors un embargo à l’île de Cuba afin d’isoler le régime.
Or, alors que l’Empire soviétique s’est écroulé il
y a 15 ans, le régime castriste tient bon. Comment expliquer
que les Américains soient «venus à bout» de la
super-puissance soviétique mais pas du fragile régime cubain?
Dans le premier
cas, dès 1971 (sous Richard Nixon) puis dans les années 1980
(sous Ronald Reagan), ils ont entrepris un dialogue et une ouverture avec
les terribles Soviétiques d'alors. Résultat: l’empire
communiste s’est désintégré en 1991. Par contre,
en isolant le régime communiste de Cuba, ils le maintiennent en
vie artificiellement. Voilà un autre exemple qui montre que
par la force, on ne résout jamais rien, alors que seule l’ouverture
et la négociation mènent finalement à des résultats.
Combien de temps
faudra-t-il encore à certains de nos dirigeants crétins pour
comprendre cela?!
.
2009 : année
de craintes ou…
le début d’un temps
nouveau ?
En ce début
de 2009, nous ressentons tous un certain malaise, pour ne pas dire une
crainte profonde: que nous réserve les douze prochains mois?
Nous sommes, nous
dit-on, au début d’une grave crise économique, vraisemblablement
la plus sévère depuis la Grande dépression des années
1930. Ce qu’on ne nous dit pas, c’est que nous vivrons peut-être
quelque chose de plus terrible encore! De fait, le système
bancaire américain est en faillite, miné par des milliards
$ de «créances toxiques». Le gouvernement tente
bien, sans trop savoir comment, de sauver les banques sans créer
une panique générale. Le fait est que le crédit
sur lequel repose notre système économique s’est enrayé.
Évidemment,
aucun expert ne peut nous dire ce qui se passera en 2009. Personne
ne peut nous dire quel sera l’ampleur de la crise, jusqu’où elle
frappera et, surtout, combien de temps elle durera. Certains avancent
que nous devrons travers toute l’année avant de voir l’activité
économique reprendre en 2010. D’autres, plus optimistes (ou
soucieux de nous rassurer un brin?) énoncent que la situation pourrait
s’améliorer à l’automne 2009. Mais la crise pourrait
tout aussi bien durer jusqu'en 2011 ou 2012…
Pour chacun d’entre
nous, la question se pose donc: jusqu’à quel point serons-nous touché
par la crise? Sommes-nous à risque de perdre notre emploi,
ou de connaître une baisse significative de nos revenus? Courrons-nous
même le risque de «tout» perdre?
Chose étonnante,
il y a un an à peine, personne ne soupçonnait la gravité
de ce que nous vivons aujourd’hui. Même les plus pessimistes
n’auraient pu imaginer un effondrement aussi spectaculaire de l’économie
américaine (et, par-delà, mondiale). De même,
personne ne peut aujourd’hui imaginer où nous en serons dans douze
mois.
L’espoir de tous,
c’est évidemment l’entrée en fonction du nouveau président
Barack Obama. Celui-ci a cependant une tâche colossale: comme
si, aux commandes d’un gigantesque avion sévèrement endommagé,
il devait le réparer tout en le maintenant en vol.
Une époque Historique ?
Une autre façon
de considérer la crise actuelle est d’imaginer que nous vivons peut-être
une époque de changements aussi déterminants que ce que fut
la fin des années 1960.
Aujourd’hui, on
évoque souvent avec nostalgie ces fameuses années soixante,
époque durant laquelle la société a éclaté,
où les carcans sociaux et religieux ont sauté pour laisser
place à de nouveaux modes de vie. Entre autres, les carcans
du mariage-pour-la-vie et de la famille incontournable ont été
rejetés, de même que celui du «papa a raison»
(autrement dit: de l’homme père de famille et pourvoyeur qui impose
ses volontés à toute sa famille). Les jeunes d’alors
se sont révoltés contre l’autorité afin de mener leur
vie à leur guise.
C’était la
«belle époque» des grandes contestations estudiantines,
des violentes manifestations et d’émeutes de la part des travailleurs
et d’une foule de groupes revendicateurs (dont le mouvement féministe).
La société éclatait de toute part. Ce faisant,
certaIns ont réalisé une foule d’expériences, dont
vivre en commune, le sexe libre, de nouvelles formes de musiques, l’expérimention
avec des drogues psychédéliques (LSD), etc. Ils ont
aussi rêvé d’utopies politiques: communisme, marxisme, maoïsme…
«C’était le bon temps!» dit-on aujourd’hui, en oubliant
toutefois de dire que cet éclatement de toutes parts inquiétait
grandement la majorité de ceux qui vivaient en ces temps troubles…
un peu comme ce que nous vivons actuellement.
Peut-être
que comme eux, vivons-nous une époque semblable (bien que différente).
Cette fois, c’est le système économique qui éclate,
ce qui pourrait nous fournir l’occasion de repenser certaines de nos valeurs.
Il s’agirait de se libérer de l’oppression plus insidieuse de la
mode (du glam et de l’hypersexualisation) et de la surconsommation
à crédit. Ce pourrait être aussi l’occasion de
prendre conscience de certaines formes d’esclavage moderne, comme celle
imposée par le téléphone cellulaire et autres moyens
de communication qui nous font nous sentir obligés d’être
joignables en tout temps et en toute circonstance.
Ainsi, peut-être
que, comme il y a quarante ans, le temps est venu de questionner nos valeurs?
Et si on mettait à profit la crise actuelle pour nous affranchir
de certains jougs?
Qui sait, peut-être
transformerons-nous l’époque trouble que nous vivons en une époque
qui fera rêver les générations à venir? |
|



